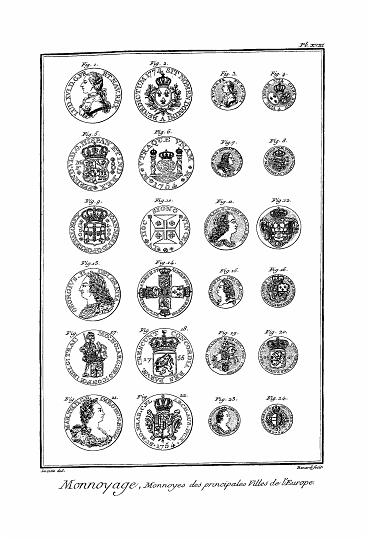- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Jurisprudence
Ce mot vient du latin munus, lequel en droit signifie trois choses différentes, savoir, don ou présent fait pour cause, charge ou devoir, et office ou fonction publique.
Les Romains appelèrent leurs offices ou fonctions publiques munera, parce que dans l'origine c'était la récompense de ceux qui avaient bien mérité du public.
Par succession de temps plusieurs offices furent réputés onéreux, tels que ceux des décurions des villes, à cause qu'on les chargea de répondre sur leurs propres biens tant du revenu et autres affaires communes des villes, que des tributs du fisc, ce qui entrainait ordinairement la ruine de ceux qui étaient chargés de cette fonction, au moyen de quoi il fallut user de contrainte pour obliger d'accepter ces sortes de places et autres semblables, et alors elles furent considérées comme des charges publiques, munera quasi onera ; munus enim aliquando significat onus, aliquando honorem seu officium, dit la loi munus, au digeste de verborum signific.
- Clics : 1809
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1096
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
Dans la châtellenie de Verneuil, le marciage consiste à prendre de trois années la dépouille de l'une quand ce sont des fruits naturels, comme quand ce sont des saules ou prés ; et en ce cas, le tenancier est quitte du cens de cette année. Mais si ce sont des fruits industriaux, comme terres labourables ou vignes, le seigneur ne prend que la moitié de la dépouille pour son droit de marciage, et le tenancier ne paye que la moitié du cens de cette année.
- Clics : 1030
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1227
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1089