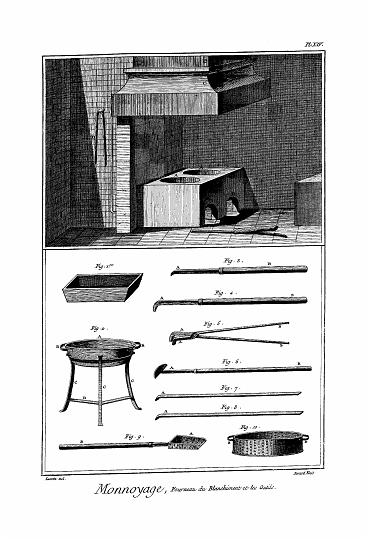- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
ETAT D'AJOURNEMENT PERSONNEL, c'est la position d'un accusé qui est decrété d'ajournement personnel. Se représenter en état d'ajournement personnel, c'est se présenter en justice prêt à répondre sur le decret. Un officier ou bénéficier qui demeure en état d'ajournement personnel, demeure interdit jusqu'à ce que le decret soit levé.
ETAT D'ASSIGNE POUR ETRE OUI, c'est la position d'un accusé décrété d'assigné pour être oui. Voyez l'article précédent.
- Clics : 1562
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1111
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1218
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1098
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 2819