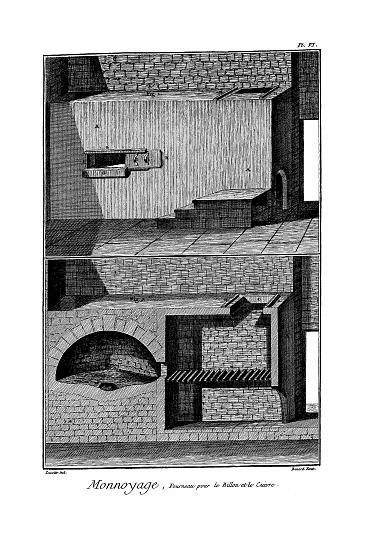- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
La formalité de l'ensaisinement vient de ce que par l'ancien usage du châtelet de Paris et de toute la prevôté, et dans plusieurs autres provinces coutumières, aucune saisie ou possession n'était acquise de droit ni de fait sans qu'il y eut dévest et vest, c'est-à-dire qu'il fallait que le vendeur se fût dessaisi entre les mains du seigneur-censier, et que ce même seigneur eut ensuite investi l'acquéreur, c'est-à-dire qu'il lui eut donné la saisine ou possession, d'où est venu le terme d'ensaisinement, lequel néanmoins ne s'applique qu'aux mises en possession des biens en roture, car la même formalité à l'égard des fiefs s'appelle inféodation.
- Clics : 1354
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1146
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1631
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
Les Bretons Anglais se révoltèrent au commencement de l'empire d'Auguste, et s'efforcèrent de secouer le joug des Romains ; mais ils furent toujours vaincus. L'empereur Claude dompta pareillement les plus rebelles. Les légions romaines que l'on envoya dans leur pays les accoutumèrent insensiblement à une espèce de dépendance. Ils furent entièrement soumis sous l'empire de Domitien, et demeurèrent tributaires des Romains jusques vers l'an 446. Il est à croire que pendant ce temps ils empruntèrent beaucoup d'usages des Romains, de même que les Gaulois.
- Clics : 1316
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1301