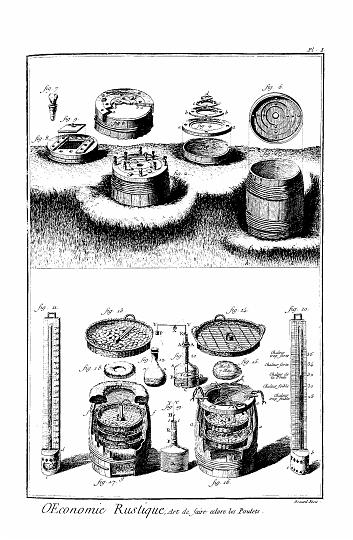- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 730
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 581
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
Pour entendre ce que c'est que ce droit de comptablie, et en quoi il diffère des droits qui se paient ailleurs, il faut observer que la généralité de Bordeaux est toute entière hors l'étendue des cinq grosses fermes, et par conséquent réputée étrangère à l'égard du reste du royaume. C'est pourquoi l'on a établi dans cette généralité divers droits d'entrée et de sortie pour toutes les marchandises. Les deux espèces les plus générales de ces droits, sont ceux de coutume et de comptablie, et ceux de convoi. Les premiers, c'est-à-dire les droits de coutume et de comptablie, sont locaux, et se perçoivent spécialement dans la sénéchaussée de Bordeaux à l'entrée et à la sortie de toutes les marchandises, vivres et denrées.
- Clics : 832
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1530
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1543