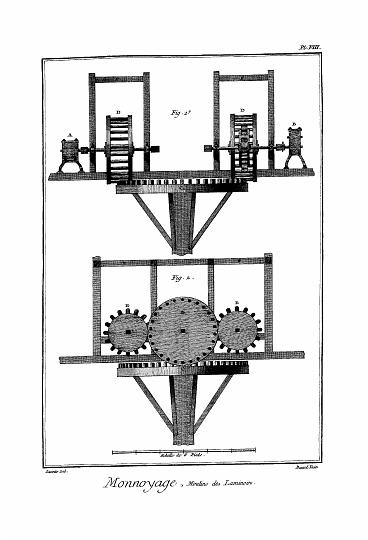- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
On dit l'institution d'une compagnie, d'une confrairie, d'une communauté, c'est-à-dire sa création, son établissement.
Quelquefois par le terme d'institution on entend l'objet pour lequel une compagnie a été établie, et la règle primitive qui lui a été imposée ; lorsqu'elle fait quelque chose de contraire, on dit qu'elle s'écarte de son institution, ou que ce n'est pas-là l'esprit de son institution. Cela se dit principalement en parlant des monastères et églises où le relâchement s'est introduit. (A).
- Clics : 1641
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 1385
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
En matière féodale, le terme d'investiture se prend quelquefois pour le titre primitif de concession du fief, et plus souvent encore pour la réception en foi et hommage.
- Clics : 1610
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
La première origine de l'insinuation vient des Romains. Les gouverneurs des provinces avaient chacun près d'eux un scribe appelé ab actis seu actuarius, qui ressemblait beaucoup à nos greffiers des insinuations. Sa fonction était de recevoir les actes de juridiction volontaire, tels que les émancipations, adoptions, manumissions, et notamment les contrats et testaments qu'on voulait insinuer et publier. On formait de tous ces actes un registre séparé de celui des affaires contentieuses.
- Clics : 1884
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Jurisprudence
- Clics : 983