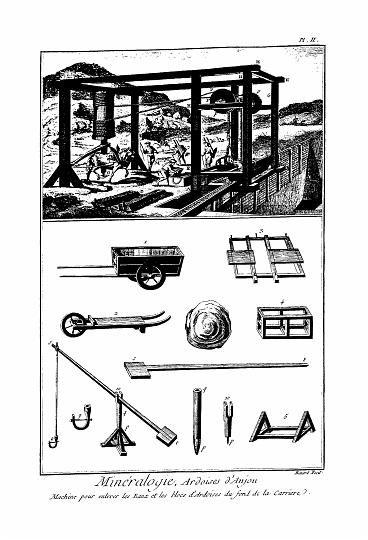- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Agriculture
Une safranière ainsi ménagée, dure trois années dans sa vigueur ; elle pourrait même continuer à rapporter pendant neuf ans, pourvu qu'on eut soin de la labourer, de la sarcler et de l'amander ; mais il vaut mieux après trois ans de production, lever hors de terre les oignons et les cayeux qu'ils ont produits pour les planter ailleurs, et vendre le surplus. Sitôt que les oignons sont hors de terre, on doit les mettre à l'ombre dans un endroit qui ne soit point humide. Il ne faut jamais les replanter dans l'endroit d'où on les a tirés, parce que la terre est usée ; il s'agit au contraire de la réparer et de la bien fumer.
- Clics : 1486
- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Agriculture
- Clics : 1763
- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Agriculture
- Clics : 1330
- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Agriculture
- Clics : 1713
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Agriculture
- Clics : 1584