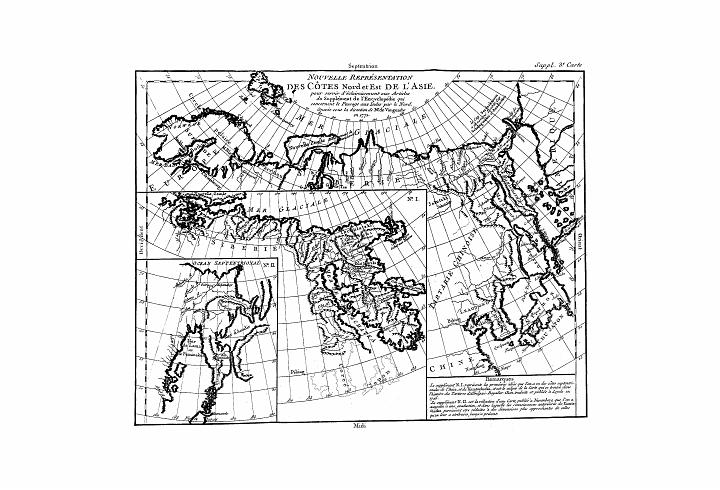- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Histoire moderne
- Clics : 1604
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Histoire moderne
- Clics : 1087
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Histoire moderne
Quand un homme en avait tué un autre, il était obligé de payer au roi et aux parents du mort, l'estimation qu'on faisait de celui-ci, et qui était plus ou moins forte, suivant sa qualité. Car du temps des Saxons, l'homicide n'était pas puni de mort, mais simplement d'une amende pécuniaire. Les Saxons avaient pris cette coutume, des anciens Germains et des Francs, chez lesquels on payait 14 liv. pour un homicide ; savoir, 3 livres pour le droit du roi appelé bannum dominicum ou fredum, du teutonique frid, qui veut dire, paix ou réconciliation, et 11 liv. pour la réparation du meurtre. Cette dernière somme qui se payait au plus proche parent se nommait wergelta, terme composé de deux mots germains gelt, argent, et weren se défendre : souvent cette composition et ces amendes enrichissaient la famille de celui qui avait été tué. Vous m'avez beaucoup d'obligation, disait dans une débauche, un certain Sichaire à Cranninide, ainsi que le rapporte Grégoire de Tours, liv. IX. ch. xix. de ce que j'ai tué vos parents ; ces différents meurtres ont fait entrer dans votre maison beaucoup de richesses qui en ont bien rétabli le désordre.
- Clics : 1128
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Histoire moderne
- Clics : 1741
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Histoire moderne
- Clics : 1252