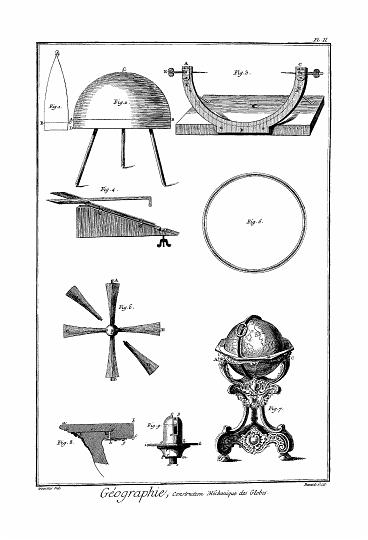- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Histoire moderne
- Clics : 1135
- Détails
- Écrit par : Denis Diderot (*)
- Catégorie : Histoire moderne
- Clics : 1131
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Histoire moderne
- Clics : 1213
- Détails
- Écrit par : Edme-François Mallet (G)
- Catégorie : Histoire moderne
Vers le commencement du XVIIe siècle, la milice turque entretenue à Alger pour garder ce royaume au nom du grand-seigneur, mécontente du gouvernement des bachas qu'on lui envoyait de Constantinople, obtint de la porte la permission d'élire parmi les troupes un homme de bon sens, de bonnes mœurs, de courage, et d'expérience, afin de les gouverner sous le nom de dey, sous la dépendance du sultan, qui envoyerait toujours un bacha à Alger pour veiller sur le gouvernement, mais non pour y présider. Les mesintelligences fréquentes entre les dey et les bachas ayant causé plusieurs troubles, Ali Baba qui fut élu dey en 1710, obtint de la porte qu'il n'y aurait plus de bacha à Alger, mais que le dey serait revêtu de ce titre par le grand-seigneur. Depuis ce temps-là le dey d'Alger s'est regardé comme prince souverain, et comme simple allié du grand-seigneur, dont il ne reçoit aucun ordre, mais seulement des capigis bachis ou envoyés extraordinaires, lorsqu'il s'agit de traiter de quelqu'affaire. Le dey tient sa cour à Alger ; sa domination s'étend sur trois provinces ou gouvernements, sous l'autorité de trois beys ou gouverneurs généraux qui commandent les armées. On les distingue par les noms de leurs gouvernements, le bey du Levant, le bey du Ponant, et le bey du Midi. Quoique le pouvoir soit entre les mains du dey, il s'en faut bien qu'il soit absolu ; la milice y forme un sénat redoutable, qui peut destituer le chef qu'elle a élu, et même le tenir dans la plus étroite et la plus fâcheuse prison, dès qu'elle croit avoir des mécontentements de sa part. Emmanuel d'Aranda en donne des exemples de faits qu'il a vus au temps de sa captivité. Ainsi le dey redoute plus cette milice, qu'il ne fait le grand-seigneur.
- Clics : 1118
- Détails
- Écrit par : Edme-François Mallet (G)
- Catégorie : Histoire moderne
- Clics : 1040