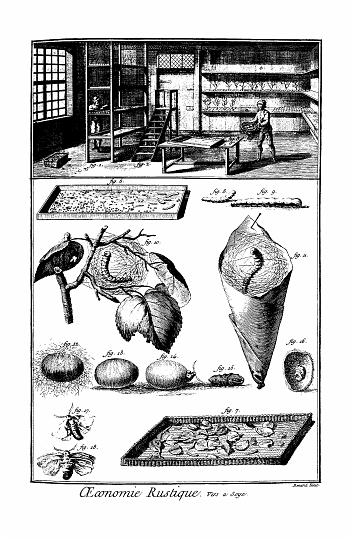- Détails
- Écrit par : Edme-François Mallet (G)
- Catégorie : Histoire & Jurisprudence
Ce mot est formé de baile, vieux terme qui signifie gouverneur, du latin bajulus qui a la même signification.
Pasquier assure que les baillis étaient originairement une sorte de subdélégués, que l'on envoyait dans les provinces pour examiner si les comtes, qui étaient alors les juges ordinaires, rendaient exactement la justice. Loiseau rapporte plus vraisemblablement l'origine des baillis, à l'usurpation et à la négligence des grands seigneurs, qui s'étant emparés de l'administration de la justice, et étant trop faibles pour ce fardeau, s'en déchargèrent sur des députés qu'on appela baillis. Ces baillis eurent d'abord l'inspection des armes et l'administration de la justice et des finances : mais comme ils abusèrent de leur pouvoir, ils en furent insensiblement dépouillés, et la plus grande partie de leur autorité fut transferée à leurs lieutenans, qui étaient gens de robe : en France les baillis ont encore une ombre de leurs anciennes prérogatives, et sont considérés comme les chefs de leurs districts : c'est en leur nom que la justice s'administre ; c'est devant eux que se passent les contrats et les autres actes, et ce sont eux qui ont le commandement des milices.
- Clics : 2965
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Histoire & Jurisprudence
Pour bien entendre ce qui fait la matière du digeste, et dans quelles circonstances il a été composé, il faut d'abord savoir quelles étaient les anciennes lois qui ont précédé le digeste, et quelle était la fonction des jurisconsultes, dont les livres ont servi à faire cette compilation.
- Clics : 3831
- Détails
- Écrit par : Edme-François Mallet (G)
- Catégorie : Histoire & Jurisprudence
- Clics : 2177
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Histoire & Jurisprudence
Ce mot décime vient du latin decima, qui signifie en général la dixième partie d'une chose. Ce mot decima a d'abord été appliqué à la dixme, parce que dans l'origine elle était par-tout du dixième des fruits : ce même mot decima a aussi été appliqué aux décimes, parce que les premières levées qui furent faites de cette espèce, étaient aussi du dixième des fruits et revenus ; en sorte que le mot latin decima signifie également dixme et décime, quoique ce soient deux choses fort différentes, puisque la dixme se paye à l'Eglise, au lieu que les décimes sont fournis au roi par le clergé : c'est pourquoi dans notre langue on a eu l'attention de distinguer ces deux objets en appelant dixme la portion des fruits que les fidèles donnent à l'Eglise ; et décime, ce que l'Eglise paye au roi pour cette subvention.
- Clics : 2509
- Détails
- Écrit par : Antoine-Gaspard Boucher d'Argis (A)
- Catégorie : Histoire & Jurisprudence
Anciennement ces sortes de combats étaient autorisés en certains cas : la justice même les ordonnait quelquefois comme une preuve juridique, quand les autres preuves manquaient, on appelait cela, le jugement de Dieu, ou le plait de l'épée, placitum ensis. On disait aussi gage de duel, ou gage de bataille ; parce que l'aggresseur jetait son gant ou autre gage par terre ; et lorsque le défendeur le ramassait en signe qu'il acceptait le duel, cela s'appelait accepter le gage.
- Clics : 2864