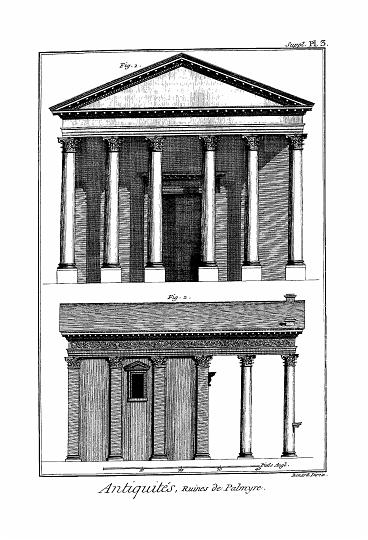S. m. (Mythologie) les satyres étaient selon la fable des divinités champêtres, qu'elle représente comme de petits hommes fort velus, avec des cornes et des oreilles de chèvres ; la queue, les cuisses, et les jambes du même animal ; quelquefois ils n'ont que les pieds de chèvre. On fait naître les satyres de Mercure et de la nymphe Yphtimé, ou bien de Bacchus et de la nayade Nicée, qu'il avait enivrée, en changeant en vin l'eau d'une fontaine où elle buvait ordinairement. Le poète Nonnus dit qu'originairement les satyres avaient la forme toute humaine ; ils gardaient Bacchus, mais comme Bacchus malgré toutes ses gardes, se changeait tantôt en bouc, tantôt en fille, Junon irritée de ces changements, donna aux satyres des cornes et des pieds de chèvres.
Pline le naturaliste prend les satyres des poètes, pour une espèce de singes, et il assure que dans une montagne des Indes, il se trouve des satyres à quatre pieds, qu'on prendrait de loin pour des hommes ; ces sortes de singes ont souvent épouvanté les bergers, et poursuivi quelquefois les bergeres ; c'est peut-être ce qui a donné lieu à tant de fables touchant leur complexion amoureuse ; ajoutez qu'il est souvent arrivé que des bergers couverts de peaux de chèvres, ou des prêtres, aient contrefait les satyres, pour séduire d'innocentes bergeres. Dès-là l'opinion se répandit que les bois étaient remplis de ces divinités malfaisantes ; les bergeres tremblèrent pour leur honneur, et les bergers pour leurs troupeaux ; ces frayeurs firent qu'on chercha à les apaiser par des sacrifices et par des offrandes.
Pausanias rapporte qu'un certain Euphémus ayant été jeté par la tempête, avec son vaisseau, sur les côtes d'une île déserte, vit venir à lui des espèces d'hommes sauvages tout velus, avec des queues derrière le dos ; qu'ils voulurent enlever leurs femmes, et se jetèrent sur elles avec tant de fureur, qu'on eut bien de la peine à se défendre de leur brutalité. Nos navigateurs revoyent souvent les satyres, ou hommes sauvages tout velus de Pausanias ; ce sont des singes à queue. (D.J.)
SATYRE, s. f. (Poésie) poème dans lequel on attaque directement le vice, ou quelque ridicule blâmable.
Cependant la satyre n'a pas toujours eu le même fonds, ni la même forme dans tous les temps. Elle a même éprouvé chez les Grecs et les Romains, des vicissitudes et des variations si singulières, que les savants ont bien de la peine à en trouver le fil. J'ai lu, pour le chercher et pour le suivre, les traités qu'en ont fait, avec plus ou moins d'étendue, Casaubon, Heinsius, MM. Spanheim, Dacier et le Batteux. Voici le précis des lumières que j'ai puisées dans leurs ouvrages.
De l'origine des satyres parmi les Grecs. Les satyres dans leur première origine, n'avaient pour but que le plaisir et la joie ; c'étaient des farces de villages, un amusement, ou un spectacle de gens assemblés pour se délasser de leurs travaux, et pour se réjouir de leur récolte, ou de leurs vendanges. Des jeux champêtres, des railleries grossières, des postures grotesques, des vers faits sur le champ, et recités en dansant, produisirent cette sorte de poésie, à laquelle Aristote donne le nom de satyrique et de danse. C'est d'elle que naquit la tragédie, qui n'eut pas seulement la même origine, mais qui en garda assez longtemps un caractère plus burlesque, pour ainsi dire, que sérieux. Quoique tirée du poème satyrique, dit Aristote, elle ne devint grave que longtemps après. Ce fut quand ce changement lui arriva, que ce divertissement des compositions satyriques, passa de la campagne sur les théâtres, et fut attaché à la tragédie même, pour en tempérer la gravité qu'on s'était enfin avisé de lui donner.
Comme ces spectacles étaient consacrés à l'honneur de Bacchus, le dieu de la joie, et qu'ils faisaient partie de sa fête, on crut qu'il était convenable d'y introduire des Satyres, ses compagnons de débauche, et de leur faire jouer un rôle également comique par leur équipage, par leurs actions et par leurs discours. On voulut par ce moyen égayer le théâtre, et donner matière de rire aux spectateurs, dans l'esprit desquels on venait de répandre la terreur et la tristesse par des représentations tragiques. La différence qui se trouvait entre la tragédie et les satyres des Grecs, consistait uniquement dans le rire que la première n'admettait pas, et qui était de l'essence de ces dernières. C'est pourquoi Horace les appelle d'un côté, agrestes satyros, eu égard à leur origine, et risores satyros, par rapport à leur but principal.
Du temps auquel on jouait ces pièces satyriques. Ainsi le nom de satyre ou satyri, demeura attaché parmi les Grecs, aux pièces de théâtre dont nous venons de parler ; et qui d'abord furent entremêlées dans les actes des tragédies, non pas tant pour en marquer les intervalles, que comme des intermèdes agréables, à quoi les danses et les postures bouffonnes de ces satyres ne contribuèrent pas moins que leurs discours de plaisanterie. On joua ensuite séparément ces mêmes pièces, après les représentations des tragédies ; ainsi qu'on joua à Rome, et dans le même but, les espèces de farces nommées exodes. Voyez EXODE.
Ces poèmes satyriques firent donc la dernière partie de ces célèbres représentations des pièces dramatiques, à qui on donna le nom de tétralogie parmi les Grecs. Voyez TETRALOGIE.
Des personnages des satyres. Si dans les commencements les pièces satyriques n'avaient pour acteurs que des satyres ou des silènes, les choses changèrent ensuite. Le Cyclope d'Euripide, les titres des anciennes pièces satyriques et plusieurs auteurs, nous apprennent que les dieux, ou demi-dieux, et des héroïnes, comme Omphale, y trouvaient leurs places, et en faisaient même le sujet principal. Le sérieux se mêla quelquefois parmi le burlesque des acteurs qui faisaient le rôle des Silènes ou des Satyres. En un mot, la satyrique, car on la nommait aussi de ce nom, tenait alors le milieu entre la tragédie et l'ancienne comédie. Elle avait de commun avec la première la dignité des personnages qu'on y faisait entrer, comme nous venons de voir, et qui d'ordinaire étaient pris des temps héroïques ; et elle participait de l'autre, par des railleries libres et piquantes, des expressions burlesques, et un dénouement de la fable, dénouement le plus souvent gai et heureux. C'est ce que nous apprend le grand commentateur grec d'Homère, Eustathius. C'est le propre du poème satyrique, nous dit-il, de tenir le milieu entre le tragique et le comique. Voilà presque le comique larmoyant de nos jours, dont l'origine est toute grecque, sans que nous nous en fussions douté.
Différence entre les pièces satyriques et comiques. Quelque rapport qu'il y eut entre les pièces satyriques et celles de l'ancienne comédie, je ne crois pas qu'elles aient été confondues par des auteurs anciens. Il restait des différences assez grandes qui les distinguaient, soit à l'égard des sujets qui dans les pièces satyriques étaient pris d'ordinaire des fables anciennes, et des demi-dieux ou des héros, soit en ce que les satyres y intervinrent avec leurs danses, et dans l'équipage qui leur est propre, soit de ce que leurs plaisanteries avaient plutôt pour but de divertir et de faire rire, que de mordre et de tourner en ridicule leurs concitoyens, leurs villes et leurs pays, comme Horace dit de Lucilius, l'imitateur d'Aristophane et de ses pareils. J'ajoute que la composition n'en était pas la même, et que l'ancienne comédie ne se lia point aux vers Iambiques, comme firent les pièces satyriques des Grecs. Concluons que ce fut aux poèmes dramatiques, dans lesquels intervenaient des Satyres avec leurs danses et leurs équipages, que demeura attaché parmi les Grecs le même nom de satyre, celui de satyrique ou de pièces satyriques, .
Des satyres romaines. Ce fut parmi les Romains que le mot de satyre, de quelque manière qu'on l'écrive, satira, satyra, satura, ou quelque origine qu'on lui donne, fut appliqué à des compositions différentes, et d'autre nature que les poèmes satyriques des Grecs, c'est-à-dire qui n'étaient, comme ceux-ci, ni dramatiques, ni accompagnés de Satyres, de leurs équipages et de leurs danses, ni faites d'ailleurs dans le même but. On donna ce nom à Rome, en premier lieu à un poème réglé et mêlé de plaisanteries, et qui eut cours avant même que les pièces dramatiques y fussent connues, mais qui cessa ou y changea de nom, et fit place à d'autres passetemps, comme on l'apprend de Tite-Live.
On communiqua ensuite le nom de satyre à un poème mêlé de diverses sortes de vers, et attaché à plus d'un sujet, comme firent les satyres d'Ennius, ou comme Ciceron l'appele, poèma varium et elegans, en parlant de celles de Varron, qui étaient tout ensemble un mélange de vers et de pièces de littérature et de philosophie, dont il nous apprend lui-même dans cet orateur, le but et la variété.
On donna enfin ce nom de satyre au poème de Lucilius, qui au rapport d'un de ses imitateurs, avait tout le caractère de l'ancienne comédie ; hinc omnis pendet Lucilius, c'est-à-dire par la même licence qu'il s'y donna, d'y reprendre non-seulement les vices en général, mais les vicieux de son temps d'entre ses citoyens, sans y épargner même les noms des magistrats et des grands de Rome.
Ce fut là, si on en croit Horace et bien d'autres, la première origine et le premier auteur de ce poème inconnu aux Grecs, à qui le nom de satyre demeura comme propre et attaché parmi les Romains, et tel qu'il l'est encore aujourd'hui dans l'usage des langues vulgaires. C'est aussi sur ce modèle que furent formés ensuite, comme on sait, les satyres du même Horace, de Perse et de Juvenal, sans toucher ici au caractère particulier que chacun d'eux y apporta, suivant son génie, ou celui de son siècle. Et c'est enfin sur ces grands exemples que les auteurs modernes français, italiens, anglais et autres, ont formé les poèmes qu'ils ont publiés sous ce même nom de satyres.
Je laisse maintenant à juger de la contestation de deux savants critiques du siècle passé, dont l'un Casaubon, prétend que la satyre des Romains n'a rien de commun avec les pièces satyriques des Grecs, ni dans l'origine et la signification du mot, ni dans la chose, c'est à-dire dans la matière et dans la forme ; et dont l'autre, Daniel Heinsius, au contraire, y croit trouver une même origine, une même matière, une même forme et un même but. Il est certain qu'il y a des différences trop essentielles entre les unes et les autres pour les confondre ; et par conséquent. l'on doit plutôt s'en rapporter au sentiment de Casaubon, qui a le premier débrouillé cette matière dans le traité qu'il en a mis au jour. Je vais exposer en peu de mots ces différences, parce que le traité de Casaubon est latin, et qu'on n'a rien publié sur cette matière en français, même dans les mémoires de l'académie des Inscriptions jusqu'à ce jour, pour la décision de cette dispute.
Différence entre les satyres des Grecs, et les satyres latines. La première différence, dont on ne peut disconvenir, c'est que les satyres, ou poèmes satyriques des Grecs, étaient des pièces dramatiques ou de théâtre, ce qu'on ne peut pas dire des satyres Romaines prises dans aucun genre. Les Latins eux-mêmes, quand ils font mention de la poésie satyrique des Grecs, lui donnent le nom de fabula, qui signifie le drame des Grecs, et n'attribuent jamais ce mot aux satyres latines.
La seconde différence vient de ce qu'il y a même quelque diversité dans le nom ; car les Grecs donnaient à leurs poèmes le nom de satyrus, ou satyri, de satyrique, de pièces satyriques, à cause des satyres, ces hôtes des bois, et ces compagnons de Bacchus qui y jouaient leur rôle, d'où vient qu'Horace appelle ceux qui en étaient les auteurs, du nom de satyrorum inscriptores ; au lieu que les Romains ont dit satira ou satura, en parlant des premiers poèmes. Ciceron appelle poema varium, les satyres de Varron, et Juvenal donne le nom de farrago à ces satyres.
La troisième différence, est que l'introduction des Silènes et des Satyres qui composaient les chœurs des poemes satyriques des Grecs en constituent l'essence, tellement qu'Horace s'arrête à montrer de quelle manière on doit y faire parler les satyres, et ce qu'on leur doit faire éviter ou conserver. On peut y ajouter l'action de ces mêmes Satyres, puisque les danses étaient si fort de l'essence de la pièce, que non-seulement Aristote les y joint, mais qu'Athenée parle nommément des trois différentes sortes de danses attachées au théâtre, la tragique, la comique et la satyrique.
La quatrième différence résulte des sujets assez divers des uns et des autres. Les satyres des Grecs prenaient d'ordinaire le leur de sujets fabuleux ; des héros, par exemple, ou des demi-dieux des siècles passés. Les satyres romaines s'attachaient à reprendre les vices, ou les erreurs de leur siècle et de leur patrie ; à y jouer des particuliers de Rome, un Mutius entr'autres, et un Lupus dans Lucilius ; un Milonius, un Nomentanus dans Horace ; un Crispinus et un Locutius dans Juvenal. Je ne parle point ici de ce que ce dernier n'y épargne pas Domitien, sous le nom de Néron ; et qu'après tout, il n'y avait rien de feint dans ces personnages, et dans les actions qu'ils en étalent, ou dans les vers qu'ils en rapportent.
La cinquième différence parait encore de la manière dont les uns et les autres traitent leurs sujets, et dans le but principal qu'ils s'y proposent. Celui de la poésie satyrique des Grecs, est de tourner en ridicule des actions sérieuses ; de travestir pour ce sujet leurs dieux ou leurs héros ; d'en changer le caractère selon le besoin ; en un mot, de rire et de plaisanter : de sorte que de tels ouvrages s'appellent en grec des jeux et des jouets, joci, comme dit Horace ; et c'est à quoi contribuaient d'ailleurs leurs danses et leurs postures, au lieu que les satyres romaines, témoin celles qui nous restent, et auxquelles ce nom d'ailleurs est demeuré comme propre, avaient moins pour but de plaisanter, que d'exciter de la haine, de l'indignation, ou du mépris : en un mot elles s'attachent plus à reprendre et à mordre, qu'à faire rire ou à folâtrer. Les auteurs y prennent la qualité de censeurs, plutôt que celle de bouffons.
Je ne touche pas la différence qu'on pourrait encore alléguer de la composition diverse des unes et des autres, par rapport à la versification. Les satyres romaines, du moins celles qui nous ont été conservées jusqu'à ce jour, ayant été écrites le plus généralement en vers héroïques, et les poèmes satyriques des Grecs, en vers iambiques. Cette réflexion est cependant d'autant plus remarquable, qu'Horace ne trouve point d'autre différence entre l'inventeur des satyres romaines, et les auteurs de l'ancienne comédie, comme Cratinus et Eupolis, sinon que les satyres du premier étaient écrites dans un autre genre de vers.
Enfin il y a lieu, ce me semble, de s'en tenir au jugement d'Horace, de Quintilien, et d'autres auteurs anciens, qui assurent que l'invention de la satyre, à qui ce nom est demeuré particulièrement appliqué chez les Romains, et depuis dans les langues vulgaires ; que cette invention, dis-je, est dû. toute entière à Lucilius ; que c'est une sorte de poésie purement romaine, comme il y parait, et totalement inconnue aux Grecs ; d'où je conclus hardiment, qu'on ne peut aujourd'hui être là-dessus d'aucune autre opinion.
Ce n'est pas après tout, que les satyres des Grecs, leurs danses et leurs railleries, n'aient été connues des Romains. On sait que dans leurs fêtes et dans leurs processions, il y avait entr'autres des chœurs de Silènes et de Satyres, vêtus et parés à leur mode, et qui par leurs danses et leurs singeries, égayaient les spectateurs. La même chose se pratiquait dans la pompe funèbre des gens de qualité, et même dans les triomphes ; et ces vers licencieux et ces railleries piquantes, que les soldats qui accompagnaient la pompe chantaient contre les triomphateurs, montraient que ces sortes de jeux satyriques, si l'on me permet cette expression, furent bien connus des Romains.
Mais il est temps de venir à l'histoire particulière de la satyre chez les Romains, et de peindre les différents caractères de leurs poètes célèbres en ce genre.
Caractères des poètes satyriques romains. Ce furent les Toscans qui apportèrent la satyre à Rome ; et elle n'était autre chose alors qu'une sorte de chanson en dialogue, dont tout le mérite consistait dans la force et la vivacité des reparties. On les nomma satyres, parce que, dit-on, le mot latin satura, signifiant un bassin dans lequel on offrait aux dieux toutes sortes de fruits à la fais, et sans les distinguer ; il parut qu'il pourrait convenir, dans le sens figuré, à des ouvrages où tout était mêlé, entassé sans ordre, sans régularité, soit pour le fond, soit pour la forme.
Livius Andronicus, qui était grec d'origine, ayant donné à Rome des spectacles en règle, la satyre changea de forme et de nom. Elle prit quelque chose du dramatique, et paraissant sur le théâtre, soit avant, soit après la grande pièce, quelquefois même au milieu, on l'appelait isode, pièce d'entrée, ; ou exode, pièce de sortie, ; ou pièce d'entr'acte, . Voilà quelles furent les deux premières formes de la satyre chez les Romains.
Elle reprit son premier nom sous Ennius et Pacuvius, qui parurent quelque temps après Andronicus ; mais elle le reprit à cause du mélange des formes, qui fut très-sensible dans Ennius ; puisqu'il employait toutes sortes de vers, sans distinction, et sans s'embarrasser de les faire symétriser entr'eux, comme on voit qu'ils symétrisent dans les odes d'Horace.
Térentius Varron fut encore plus hardi qu'Ennius dans la satyre qu'il intitula Ménippe, à cause de sa ressemblance avec celle de Ménippée cynique grec. Il fit un mélange de vers et de prose : et par conséquent il eut droit plus que personne de nommer son ouvrage satyre, en faisant tomber la signification du mot sur la forme.
Enfin arriva Lucilius qui fixa l'état de la satyre, et la présenta telle que nous l'ont donnée Horace, Perse, Juvenal, et telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et alors la signification du mot satyre ne tomba que sur le mélange des choses, et non sur celui des formes. On les nomma satyres, parce qu'elles sont réellement un amas confus d'invectives contre les hommes, contre leurs désirs, leurs craintes, leurs emportements, leurs folles joies, leurs intrigues.
Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas
Gaudia, discursus, nostri est farrago libelli.
Juv. Sat. I.
On peut donc définir la satyre d'après son caractère fixé par les Romains, une espèce de poème dans lequel on attaque directement les vices ou les ridicules des hommes. Je dis une espèce de poème, parce que ce n'est pas un tableau, mais un portrait du vice des hommes, qu'elle nomme sans détour, appelant un chat un chat, et Néron un tyran.
C'est une des différences de la satyre avec la comédie. Celle-ci attaque les vices, mais obliquement et de côté. Elle montre aux hommes des portraits généraux, dont les traits sont empruntés de différents modèles ; c'est au spectateur à prendre la leçon lui-même, et à s'instruire s'il le juge à propos. La satyre au contraire Ve droit à l'homme. Elle dit : C'est vous, c'est Crispin, un monstre, dont les vices ne sont rachetés par aucune vertu.
La satyre en leçons, en nouveautés fertile,
Sait seule assaisonner le plaisant et l'utîle ;
Et d'un vers qu'elle épure aux rayons du bon sens,
Détrompe les esprits des erreurs de leur temps.
Elle seule bravant l'orgueil et l'injustice,
Va jusques sous le dais faire pâlir le vice :
Et souvent sans rien craindre, à l'aide d'un bon mot,
Va venger la raison des attentats d'un sot.
Boileau.
Comme il y a deux sortes de vices, les uns plus graves, les autres moins ; il y a aussi deux sortes de satyres : l'une qui tient de la tragédie, grande Sophocleo carmen bacchatur hiatu ; c'est celle de Juvenal. L'autre est celle d'Horace, qui tient de la comédie, admissus circum praecordia ludit.
Il y a des satyres où le fiel est dominant, fel : dans d'autres, c'est l'aigreur, acetum : dans d'autres, il n'y a que le sel qui assaisonne, le sel qui pique, le sel qui cuit.
Le fiel vient de la haine, de la mauvaise humeur, de l'injustice : l'aigreur vient de la haine seulement et de l'humeur. Quelquefois l'humeur et la haine sont enveloppées ; et c'est l'aigre-doux.
Le sel qui assaisonne ne domine point, il ôte seulement la fadeur, et plait à tout le monde ; il est d'un esprit délicat. Le sel piquant domine et perce, il marque la malignité. Le cuisant fait une douleur vive, il faut être méchant pour l'employer. Il y a encore le fer qui brule, qui emporte la pièce avec escare, et c'est fureur, cruauté, inhumanité. On ne manque pas d'exemples de toutes ces espèces de traits satyriques.
Il n'est pas difficile, après cette analyse, de dire quel est l'esprit qui anime ordinairement le satyrique. Ce n'est point celui d'un philosophe qui, sans sortir de sa tranquillité, peint les charmes de la vertu et la difformité du vice. Ce n'est point celui d'un orateur qui, échauffé d'un beau zèle, veut réformer les hommes, et les ramener au bien. Ce n'est pas celui d'un poète qui ne songe qu'à se faire admirer en excitant la terreur et la pitié. Ce n'est pas encore celui d'un misantrope noir, qui haït le genre humain, et qui le haït trop pour vouloir le rendre meilleur. Ce n'est ni un Héraclite qui pleure sur nos maux, ni un Démocrite qui s'en moque : qu'est - ce donc ?
Il semble que, dans le cœur du satyrique, il y ait un certain germe de cruauté enveloppé, qui se couvre de l'intérêt de la vertu pour avoir le plaisir de déchirer au-moins le vice. Il entre dans ce sentiment de la vertu et de la méchanceté, de la haine pour le vice, et au-moins du mépris pour les hommes, du désir pour se venger, et une sorte de dépit de ne pouvoir le faire que par des paroles : et si par hasard les satyres rendaient meilleurs les hommes, il semble que tout ce que pourrait faire alors le satyrique, ce serait de n'en être pas fâché. Nous ne considérons ici l'idée de la satyre qu'en général, et telle qu'elle parait résulter des ouvrages qui ont le caractère satyrique de la façon la plus marquée.
C'est même cet esprit qui est une des principales différences qu'il y a entre la satyre et la critique. Celle-ci n'a pour objet que de conserver pures les idées du bon et du vrai dans les ouvrages d'esprit et de gout, sans aucun rapport à l'auteur, sans toucher ni à ses talents, ni à rien de ce qui lui est personnel. La satyre au contraire cherche à piquer l'homme même ; et si elle enveloppe le trait dans un tour ingénieux, c'est pour procurer au lecteur le plaisir de paraitre n'approuver que l'esprit.
Quoique ces sortes d'ouvrages soient d'un caractère condamnable, on peut cependant les lire avec beaucoup de profit. Ils sont le contrepoison des ouvrages où règne la molesse. On y trouve des principes excellents pour les mœurs, des peintures frappantes qui réveillent. On y rencontre de ces avis durs, dont nous avons besoin quelquefois, et dont nous ne pouvons guère être redevables qu'à des gens fâchés contre nous : mais en les lisant, il faut être sur ses gardes, et se préserver de l'esprit contagieux du poète qui nous rendrait mécans, et nous ferait perdre une vertu à laquelle tient notre bonheur, et celui des autres dans la société.
La forme de la satyre est assez indifférente par elle-même. Tantôt elle est épique, tantôt dramatique, le plus souvent elle est didactique ; quelquefois elle porte le nom de discours, quelquefois celui d'épitre ; toutes ces formes ne font rien au fond ; c'est toujours satyre, dès que c'est l'esprit d'invectives qui l'a dictée. Lucilius s'est servi quelquefois du vers ïambique : mais Horace ayant toujours employé l'hexamètre, on s'est fixé à cette espèce de vers. Juvenal et Perse n'en ont point employé d'autres ; et nos satyriques français ne se sont servis que de l'alexandrin.
Caius Lucilius, né à Aurunce, ville d'Italie, d'une famille illustre, tourna son talent poétique du côté de la satyre. Comme sa conduite était fort régulière, et qu'il aimait par tempérament la décence et l'ordre, il se déclara l'ennemi des vices. Il déchira impitoyablement entr'autres un certain Lupus, et un nommé Mutius, genuinum fregit in illis. Il avait composé plus de trente livres de satyres, dont il ne nous reste que quelques fragments. A en juger par ce qu'en dit Horace, c'est une perte que nous ne devons pas fort regretter : son style était diffus, lâche, les vers durs ; c'était une eau bourbeuse qui coulait, ou même qui ne coulait pas, comme dit Jules Scaliger. Il est vrai que Quintilien en a jugé plus favorablement : il lui trouvait une érudition merveilleuse, de la hardiesse, de l'amertume, et même assez de sel. Mais Horace devait être d'autant plus attentif à le bien juger, qu'il travaillait dans le même genre, que souvent on le comparait lui-même avec ce poète ; et qu'il y avait un certain nombre de savants qui, soit par amour de l'antique, soit pour se distinguer, soit en haine de leurs contemporains, le mettaient au-dessus de tous les autres poètes. Si Horace eut voulu être injuste, il était trop fin et trop prudent pour l'être en pareil cas ; et ce qu'il dit de Lucilius est d'autant plus vraisemblable, que ce poète vivait dans le temps même où les lettres ne faisaient que de naître en Italie. La facilité prodigieuse qu'il avait n'étant point réglée, devait nécessairement le jeter dans le défaut qu'Horace lui reproche. Ce n'était que du génie tout pur et un gros feu plein de fumée.
Horace profita de l'avantage qu'il avait d'être né dans le plus beau siècle des lettres latines. Il montra la satyre avec toutes les grâces qu'elle pouvait recevoir, et ne l'assaisonna qu'autant qu'il le fallait pour plaire aux gens délicats, et rendre méprisables les méchants et les sots.
Sa satyre ne présente guère que les sentiments d'un philosophe poli, qui voit avec peine les travers des hommes, et qui quelquefois s'en divertit : elle n'offre le plus souvent que des portraits généraux de la vie humaine ; et si de temps en temps elle donne des détails particuliers, c'est moins pour offenser qui que ce sait, que pour égayer la matière et mettre la morale en action. Les noms sont presque toujours feints : s'il y en a de vrais, ce ne sont jamais que des noms décriés et de gens qui n'avaient plus de droit à leur réputation. En un mot, le génie qui animait Horace n'était ni méchant, ni misantrope, mais ami délicat du vrai, du bon, prenant les hommes tels qu'ils étaient, et les croyant plus souvent dignes de compassion ou de risée que de haine.
Le titre qu'il avait donné à ses satyres et à ses épitres marque assez ce caractère. Il les avait nommés sermones, discours, entretiens, réflexions faites avec des amis sur la vie et les caractères des hommes. Il y a même plusieurs savants qui ont rétabli ce titre comme plus conforme à l'esprit du poète et à la manière dont il présente les sujets qu'il traite. Son style est simple, léger, vif, toujours modéré et paisible ; et s'il corrige un sot, un faquin, un avare, à peine le trait peut-il déplaire à celui même qui en est frappé.
Je suis bien éloigné de mettre la poésie de son style et la versification de ses satyres au niveau de celles de Virgile, mais du-moins on y sent par-tout l'aisance et la délicatesse d'un homme de cour, qui est le maître de sa matière, et qui la réduit au point qu'il juge à propos, sans lui ôter rien de sa dignité. Il dit les plus belles choses, comme les autres disent les plus communes, et n'a de négligence que ce qu'il en faut pour avoir plus de grâces.
Perse (Aulus Persius Flaccus) vint après Horace, il naquit à Volaterre, ville d'Etrurie, d'une maison noble et alliée aux plus grands de Rome. Il était d'un caractère assez doux, et d'une tendresse pour ses parents qu'on citait pour exemple. Il mourut âgé de 30 ans, la 8e année du règne de Néron. Il y a dans les satyres qu'il nous a laissées des sentiments nobles ; son style est chaud, mais obscurci par des allégories souvent recherchées, par des ellipses fréquentes, par des métaphores trop hardies.
Perse en ses vers obscurs, mais serrés et pressants,
Affecta d'enfermer moins de mots que de sens.
Quoiqu'il ait tâché d'être l'imitateur d'Horace, cependant il a une seve toute différente. Il est plus fort, plus vif, mais il a moins de grâces. Il est même un peu triste : et soit la vigueur de son caractère, soit le zèle qu'il a pour la vertu, il semble qu'il entre dans sa philosophie un peu d'aigreur et d'animosité contre ceux qu'il attaque.
Juvénal (Decimus Junius Juvenalis) natif d'Aquino, au royaume de Naples, vivait à Rome sur la fin du règne de Domitien, et même sous Nerva et sous Trajan. Ce poète
Elevé dans les cris de l'école,
Poussa jusqu'à l'excès sa mordante hyperbole.
Ses ouvrages tous pleins d'affreuses vérités
Etincellent pourtant de sublimes beautés :
Sait que sur un écrit arrivé de Caprée,
Il brise de Séjan la statue adorée,
Sait qu'il fasse au conseil courir les sénateurs,
D'un tyran soupçonneux pâles adulateurs...
Ses écrits pleins de feu par-tout brillent aux y eux.
Perse a peut-être plus de vigueur qu'Horace ; mais en comparaison de Juvénal, il est presque froid. Celui-ci est brulant : l'hyperbole est sa figure favorite. Il avait une force de génie extraordinaire, et une bîle qui seule aurait presque suffi pour le rendre poète. Il passa la première partie de sa vie à écrire des déclamations. Flatté par le succès de quelques vers qu'il avait faits contre un certain Paris, pantomime, il crut reconnaître qu'il était appelé au genre satyrique. Il s'y livra tout entier, et en remplit les fonctions avec tant de zèle, qu'il obtint à la fin un emploi militaire, qui, sous apparence de grâce, l'exila au fond de l'Egypte. Ce fut-là qu'il eut le temps de s'ennuyer et de déclamer contre les torts de la fortune, et contre l'abus que les grands faisaient de leur puissance. Selon Jules Scaliger, il est le prince des poètes satyriques : ses vers valent beaucoup mieux que ceux d'Horace ; apparemment parce qu'ils sont plus forts : ardet, inflat, jugulat.
Ce qui a déterminé Juvénal à embrasser le genre satyrique, n'est pas seulement le nombre des mauvais poètes ; raison pourtant qui pouvait suffire. " Il a pris les armes à cause de l'excès où sont portés tous les vices. Le désordre est affreux dans toutes les conditions. On joue tout son bien ; on vole, on pille ; on se ruine en habits, en bâtiments, en repas ; on se tue de débauche ; on assassine, on empoisonne. Le crime est la seule chose qui soit récompensée ; il triomphe par-tout, et la vertu gémit ".
La quatrième satyre de ce poète présente les traits les plus mordants, et l'invective la plus animée. Il en veut à l'empereur Domitien ; et pour aller jusqu'à lui comme par degré, il présente d'abord ce favori nommé Crispin, qui d'esclave était devenu chevalier romain. Cette satyre a pour date :
Cum jam semianimum laceraret Flavius orbem
Ultimus, et calvo serviret Roma Neroni.
" Lorsque le dernier des Flavius achevait de déchirer l'univers expirant, et que Rome gémissait sous la tyrannie du chauve Néron " ; vous voyez qu'il ne dit pas sous l'empire de Domitien, comme un autre aurait pu dire. Il le surnomme Néron, pour peindre d'un seul mot sa cruauté ; il l'appelle chauve, qui était un reproche injurieux dans ce temps-là. Enfin on voit dans ce morceau soute la force, tout le fiel, toute l'aigreur de la satyre. Ce ton se soutient par-tout dans l'auteur ; ce n'est pas assez pour lui de peindre, il grave à traits profonds, il brule avec le fer.
Sa satyre X. est encore très-belle, surtout l'endroit où il brise la statue de Séjan, après avoir raillé amérement l'ambition de ce ministre, et la sottise du peuple de Rome qui ne jugeait que sur les apparences :
Turba Remi sequitur fortunam, ut semper et odit
Damnator.
C'en est assez sur les anciens satyriques romains ; parlons à-présent de ceux de notre nation qui ont marché sur leurs traces.
Caractères des poètes satyriques français.
Regnier (Mathurin), natif de Chartres, et neveu de l'abbé Desportes, fut le premier en France qui donna des satyres. Il y a de la finesse et un tour aisé dans celles qu'il a travaillées avec soin ; son caractère est aisé, coulant, vigoureux. Despréaux dit en parlant de ce poète :
Regnier seul parmi nous formé sur leurs modèles,
Dans son vieux style encore a des grâces nouvelles.
Il est quelquefois long et dissus. Quand il trouve à imiter, il Ve trop loin, et son imitation est presque toujours une traduction inférieure à son modèle ; mais ses vers sont pleins de sens et de naïveté : Heureux !
Si du son hardi de ses rimes cyniques
Il n'alarmait souvent les oreilles pudiques.
Ce qu'on peut dire pour diminuer sa faute, c'est que ne travaillant que d'après les satyriques latins, il croyait pouvoir les suivre en tout, et s'imaginait que la licence des expressions était un assaisonnement dont leur genre ne pouvait se passer.
Regnier est mort à Rouen en 1613, âgé de 40 ans. On connait l'épitaphe pleine de naïveté qu'il a faite pour lui, et dans laquelle il s'est si bien peint :
J'ai vécu sans nul pensement
Me laissant aller doucement
A la bonne loi naturelle :
Et si m'étonne fort pourquoi
La mort daigna songer à moi
Qui ne songeai jamais à elle.
Jean de la Frenaye Vauquelin, publia quelques satyres peu de temps avant la mort de Regnier ; mais comme il n'avait ni la force, ni le feu, ni le plaisant nécessaire à ce genre de poème, il ne mérite pas de nous arrêter.
Despréaux (Nicolas Boileau sieur) fleurit environ 60 ans après Regnier, et fut plus retenu que lui. Il savait que l'honnêteté est une vertu dans les écrits comme dans les mœurs. Son talent l'emporta sur son éducation : quoiqu'il fût fils, frère, oncle, cousin, beau-frère de greffier, et que ses parents le destinassent à suivre le palais, il lui fallut être poète, et qui plus est poète satyrique.
Ses vers sont forts, travaillés, harmonieux, pleins de choses ; tout y est fait avec un soin extrême. Il n'a point la naïveté de Regnier ; mais il s'est tenu en garde contre ses défauts. Il est serré, précis, décent, soigné par-tout, ne souffrant rien d'inutile, ni d'obscur. Son plan de satyre était d'attaquer les vices en général, et les mauvais auteurs en particulier. Il ne nomme guère un scélérat ; mais il ne fait point de difficulté de nommer un mauvais auteur qui lui déplait, pour servir d'exemple aux autres, et maintenir le droit du bon sens et du bon gout.
Ses expressions sont justes, claires, souvent riches et hardies. Il n'y a ni vide, ni superflu. On dit quelquefois malignement le laborieux Despréaux ; mais il travaillait plus pour cacher son travail, que d'autres pour montrer le leur. Ses ouvrages se font admirer par la justesse de la critique, par la pureté du style et par la richesse de l'expression. La plupart de ses vers sont si beaux, qu'ils sont devenus proverbes. Il semble créer les pensées d'autrui, et parait original lorsqu'il n'est qu'imitateur.
On lui reproche de manquer d'imagination ; mais où la voit-on plus brillante, plus riche et plus féconde que dans son poème du Lutrin, ouvrage bâti sur la pointe d'une aiguille, comme le disait M. de Lamoignon ; c'est un château en l'air, qui ne se soutient que par l'art et la force de l'architecte. On y trouve le génie qui crée, le jugement qui dispose, l'imagination qui enrichit, la vertu qui anime tout, et l'harmonie qui répand les grâces.
Son art poétique est un chef-d'œuvre de raison, de gout, de versification. Enfin Despréaux a une réputation au-dessus de toutes les apologies, et sa gloire sera toujours intimement liée avec celle des belles-lettres françaises.
Il naquit au village de Crône, auprès de Paris, en 1636. Il essaya du barreau, et ensuite de la sorbonne. Dégouté de ces deux chicanes, dit M. de Voltaire, il ne se livra qu'à son talent, et devint l'honneur de la France. Il fut reçu à l'académie en 1684, et mourut en 1711. Tous ses ouvrages ont été traduits en anglais. Son Art poétique a été mis en vers portugais ; et plusieurs autres morceaux de ses poésies ont été traduits en vers latins et en vers italiens. La meilleure édition qu'on ait donné de ses œuvres en français, avec d'amples commentaires, a Ve le jour à Paris en 1747, cinq vol. in-8 °.
Parallèle des satyriques romains et français. Si présentement on veut rapprocher les caractères des poètes satyriques dont nous venons de parler, pour voir en quoi ils se ressemblent, et en quoi ils diffèrent ; " il parait, dit M. le Batteux, qu'Horace et Boileau ont entr'eux plus de ressemblance, qu'ils n'en ont ni l'un ni l'autre avec Juvenal. Ils vivaient tous deux dans un siècle poli, où le goût était pur, et l'idée du beau sans mélange. Juvenal au contraire vivait dans le temps même de la décadence des lettres latines, lorsqu'on jugeait de la bonté d'un ouvrage par sa richesse, plutôt que par l'économie des ornements. Horace et Boileau plaisantaient doucement, légèrement ; ils n'ôtaient le masque qu'à demi et en riant ; Juvenal l'arrache avec colere : ses portraits ont des couleurs tranchantes, des traits hardis, mais gros ; il n'est pas nécessaire d'être délicat pour en sentir la beauté. Il était né excessif, et peut-être même que quand il serait venu avant les Plines, les Séneques, les Lucains, il n'aurait pu se tenir dans les bornes légitimes du vrai et du beau.
Perse a un caractère unique qui ne sympatise avec personne. Il n'est pas assez aisé pour être mis avec Horace. Il est trop sage pour être comparé à Juvenal ; trop enveloppé et trop mystérieux pour être joint à Despréaux. Aussi poli que le premier, quelquefois aussi vif que le second, aussi vertueux que le troisième, il semble être plus philosophe qu'aucun des trois. Peu de gens ont le courage de le lire ; cependant la première lecture une fois faite, on trouve de quoi se dédommager de sa peine dans la seconde. Il parait alors ressembler à ces hommes rares dont le premier abord est froid ; mais qui charment par leur entretien quand ils ont tant fait que de se laisser connaître ". (D.J.)
SATYRE DRAMATIQUE, (Art dramat.) genre de drame particulier aux anciens. Les satyres dramatiques, ou si l'on veut, les drames satyriques, se nommaient en latin satyri, au-lieu que les satyres telles que celles d'Horace et de Juvenal, s'appelaient saturae. Il ne nous reste de drame satyrique qu'une seule pièce de l'antiquité ; c'est le cyclope d'Euripide. Les personnages de cette pièce sont Polyphème, Ulysse, un silène et un chœur de satyres. L'action est le danger que court Ulysse dans l'antre du cyclope, et la manière dont il s'en tire. Le caractère du cyclope est l'insolence, et une cruauté digne des bêtes féroces. Le silène est badin à sa manière, mauvais plaisant, quelquefois ordurier. Ulysse est grave et sérieux, de manière cependant qu'il y a quelques endroits où il parait se prêter un peu à l'humeur bouffonne des silènes. Le chœur des satyres a une gravité burlesque, quelquefois il devient aussi mauvais plaisant que le silène. Ce que le père Brumoi en a traduit suffit pour convaincre ceux qui auront quelque doute.
Peu importe après cela, de remonter à l'origine de ce spectacle, qui fut, dit on, d'abord très-sérieux. Il est certain que du temps d'Euripide, c'était un mélange du haut et du bas, du sérieux et du bouffon. Les Romains ayant connu le théâtre grec, introduisirent chez eux cette sorte de spectacle pour réjouir non-seulement le peuple et les acheteurs de noix, mais quelquefois même les philosophes, à qui le contraste quoiqu'outré, peut fournir matière à réflexion.
Horace a prescrit dans son Art poétique, le goût qui doit régner dans ce genre de poème ; et ce qu'il en dit revient à ceci. Si l'on veut composer des drames satyriques, il ne faut pas prendre dans la partie que font les satyres la couleur ni le ton de la tragédie, il ne faut pas prendre non-plus le ton de la comédie : Davus est trop rusé ; une courtisanne qui excroque un talent à un vieil avare, tout fin qu'il est, est trop subtile. Ce caractère de finesse ne peut convenir à un Silène qui sort des forêts, qui n'a jamais été que le serviteur et le gardien d'un dieu en nourrice. Il doit être naïf, simple, du familier le plus commun. Tout le monde croira pouvoir faire parler de même les satyres, parce que leur élocution semblera entièrement négligée ; cependant il y aura un mérite secret, et que peu de gens pourront attraper, ce sera la suite et la liaison même des choses : il est aisé de dire quelques mots avec naïveté ; mais de soutenir longtemps ce ton sans être plat, sans laisser du vide, sans faire d'écarts, sans liaisons forcées, c'est peut-être le chef-d'œuvre du goût et du génie.
Je crois qu'on retrouve chez nous, à peu de chose près, les satyres dramatiques des anciens dans certaines pièces italiennes ; du-moins on retrouve dans arlequin les caractères d'un satyre. Qu'on fasse attention à son masque, à sa ceinture, à son habit collant, qui le fait paraitre presque comme s'il était nud, à ses genoux couverts, et qu'on peut supposer rentrants ; il ne lui manque qu'un soulier fourchu. Ajoutez à cela sa façon mièvre et déliée, son style, ses pointes souvent mauvaises, son ton de voix ; tout cela forme assurément une manière de satyre. Le satyre des anciens approchait du bouc ; l'arlequin d'aujourd'hui approche du chat ; c'est toujours l'homme déguisé en bête. Comment les satyres jouaient-ils, selon Horace ? avec un dieu, un héros qui parlait du haut ton. Arlequin de même parait vis-à-vis Samson ; il figure en grotesque vis-à-vis d'un héros : il fait le héros lui-même ; il représente Thésée, etc. Cours de Belles-lettres. (D.J.)