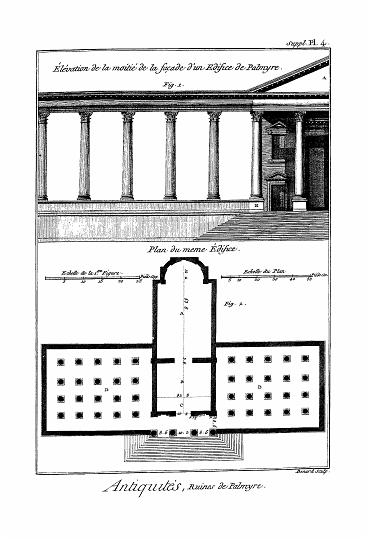(Mythologie) Selon Virgile, ce sont deux portes appelées les portes du sommeil, l'une de corne, l'autre d'ivoire. Par celle de corne passent les ombres véritables qui sortent des enfers et qui paraissent sur la terre ; par celle d'ivoire sortent les vaines illusions et les songes trompeurs. Enée sortit par la porte d'ivoire. (D.J.)
PORTES DE ROME, (Antiquité romaine) Pline dit que de son temps il y avait trente-sept portes à la ville de Rome. Il en reste encore neuf anciennes sans celles de trants Tebero et du Vatican.
La première et la principale s'appelait anciennement Flumentana ou Flaminia, aujourd'hui del Popolo, sur le bord du Tibre, vers le couchant d'hiver, selon la description de Martian, liv. I. ch. VIIIe
La seconde était à main droite en tirant vers la colline des jardinages qu'on appelait Collatina, par où on sortait pour aller à Collatie, ville des Sabins, et le grand chemin se nommait via Collatina.
La troisième était appelée anciennement Quirinalis, parce qu'on passait par-là pour aller au Quirinal ; on la nomme aujourd'hui Porta salasa, parce qu'on amène le sel par cette porte dans la ville.
La quatrième s'appelait Viminalis, à cause du mont Viminal : elle est nommée aujourd'hui Momentane ou de sainte Agnès.
La cinquième est l'Esquiline, ou la Taurine et Tiburtine, parce qu'on y passait pour aller à Tivoli.
La sixième était porta Coelimontana, par où on allait au mont Célion.
La septième se nommait porta Latina ou Ferentina, qui conduisait au pays des Latins.
La huitième s'appelait Capena, elle était au pied du mont Aventin et proche le Tibre, et elle conduisait dans la via Appia ; son nom lui venait d'une petite ville qui n'était pas éloignée de Rome : cette porte était encore appelée Fontinalis, à cause de plusieurs fontaines dont elle était environnée, ce qui fait dire à Juvénal, en parlant d'Umbricius qui quittait Rome : Substetit ad vetères arcus, madidamque Capenam, " Il s'arrêta aux anciens portiques et à la porte Capéne qui est baignée d'eau ". Enfin on appelait aussi cette porte la porte Triomphale, parce que ceux qui étaient honorés du triomphe, faisaient leur entrée par cette porte ; c'est aujourd'hui la porte saint Sébastien.
La neuvième était nommée Ostiensis et Trigemina, parce que celui des trois Horaces qui tua les trois Curiaces, entra par-là.
Il y avait trois portes en trants Tevère, in trans-Tiberina ; la première auprès du port, nommée Ripa, où abordent les barques qui viennent d'Ostie et de la mer, qu'on appelait autrefois Portuensis et Navalis. La seconde au haut du Janicule, appelée Aurelia, du chemin qu'un certain Aurelius, homme consulaire, fit paver ; on allait de cette porte le long de la mer de Toscane jusqu'à Pise. La troisième est au pied du Janicule, appelée Septimiana, de Septimus Severus qui la fit faire. (D.J.)
PORTE, (Critique sacrée) ce mot se prend souvent dans l'Ecriture au figuré ; la porte du ciel ; les portes de la justice, sont les portes du tabernacle. Les portes de la mort sont les dangers qui conduisent à la mort. Porte se prend pour la ville même, Genèse, xxiv. 60. Ce mot désigne aussi le tribunal de justice, parce que les Juifs étant la plupart employés aux travaux de la campagne, on avait établi qu'on s'assemblerait à la porte des villes, et qu'on y rendrait souverainement la justice, afin de ménager le temps de ces villageais, Deutéron. XVIe 18. On peut voir une forme de ces jugements dans l'acquisition que fait Abraham d'un champ pour enterrer Sara : c'est pourquoi le jugement, la sentence est appelée porta : ne conteras egenum in porta, Prov. xxij. 22. " n'opprimez point le pauvre dans votre jugement " ; de-là vient encore que ce mot signifie les bornes de la juridiction, Exode xxvj. 33. , Act. xiv. 13. est aussi la porte de la ville. Il est rapporté dans les mêmes Actes, que la servante Rhodes ayant aperçu Pierre, ne lui ouvrit point la porte, mais courut dans la maison pour annoncer que Pierre était là. Il y a dans le grec la porte de la porte, , dit Grotius, c'est la porte qui ferme l'ouverture, et , c'est l'ouverture même faite à la muraille, les poteaux. (D.J.)
PORTE DE SUZAN, (Critique sacrée) nom de la porte orientale extérieure du temple de Jérusalem ; cette porte fut ainsi nommée après que le temple de Jérusalem fut achevé, l'an 515 avant Jesus-Christ, en vertu de la permission de Darius, fils d'Histape, qui l'accorda dans son palais de Suze ou Suzan ; les Juifs par reconnaissance représentèrent en sculpture la ville de Suze au-dessus de la porte de ce nom ; et ce monument subsista jusqu'à la destruction du temple par les Romains.
PORTE D'UNE PLACE DE GUERRE, (Architecture mil.) la porte d'une place de guerre doit être au milieu d'une courtine pour être bien défendue des flancs et des faces : celles qui sont dans le flanc embrassent la partie la plus nécessaire de la fortification, et quand elles sont dans la face, elles embrassent encore plus la masse du bastion, dont le terrain doit être libre, et propre aux retranchements qui s'y doivent faire en cas de besoin. Le moins qu'une place ait d'entrée est le meilleur. Toutes les portes ont un pont qu'on lève tous les soirs, outre cela elles sont défendues par des herses, qui sont soutenues par une corde, qu'on lâche pour se garantir des surprises, ou des orgues, qui sont de grosses pièces de bois détachées, qu'on laisse tomber les unes après les autres, pour former une porte. (D.J.)
PORTE MERIDIONALE, (Jurisprudence) dans les anciennes coutumes, signifiait la porte d'une église tournée au midi, vers laquelle se faisait autrefois la purgation canonique, c'est-à-dire que lorsqu'on ne pouvait constater suffisamment le fait d'un crime, on conduisait l'accusé à la porte méridionale de l'église, où il faisait serment en présence du peuple, qu'il était innocent du crime dont il était accusé. Voyez PURGATION.
Cette purgation était appelée jugement de Dieu, et c'est pour cette raison que l'on faisait anciennement de vastes portiques à la porte méridionale des églises. Voyez JUGEMENT DE DIEU.
PORTE, la, (Histoire des Turcs) c'est le nom qu'on donne à l'empire des Turcs. Leurs conquêtes ont affoibli cet empire, parce qu'ils n'ont pas su les mettre à profit par de sages règlements ; détruisant pour conserver, ils n'ont acquis que du terrain. Leur religion ennemie des arts, du commerce et de l'industrie qui fait fleurir un état, a laissé régner des vainqueurs dans des provinces dévastées, et sur les débris des puissances qu'ils ont ruinées ; enfin le despotisme a produit dans la monarchie ottomane tous les maux dont il est le germe.
On a remarqué que tout gouvernement despotique devient militaire, dans ce sens que les soldats s'emparent de toute l'autorité. Le prince qui veut user d'un pouvoir arbitraire en gouvernant des hommes, ne peut avoir que de vils esclaves pour sujets ; et comme il n'y a aucune loi qui retienne sa puissance dans de certaines bornes, il n'y en a aussi aucune qui la protege, et qui soit le fondement de sa grandeur. Se servant de la milice pour tout opprimer, il est nécessaire que cette milice connaisse enfin ce qu'elle peut, et l'opprime à son tour, parce que ses forces ne peuvent être contrebalancées par des citoyens qui ne prennent aucun intérêt à la police de l'état, et qui cependant dans le cas de la révolte des gens de guerre, font la seule ressource du prince.
Soliman I. connaissant tous les dangers auxquels ses successeurs seraient exposés, fit une loi pour défendre que les princes de sa maison parussent à la tête des armées, et eussent des gouvernements de provinces. Il crut affermir les sultants sur le trône, en ensevelissant dans l'obscurité tout ce qui pouvait leur faire quelque outrage. Par cette politique il crut ôter aux janissaires le prétexte de leurs séditions, mais il ne fit qu'avilir ses successeurs. Corrompus par l'éducation du serrail, ils portèrent en imbéciles l'épée des héros qui avaient fondé et étendu l'empire. Les révolutions devinrent encore plus fréquentes ; les sultants incapables de régner, furent le jouet de l'indocilité et de l'avarice des janissaires ; ceux auxquels la nature donna quelques talents, furent déposés par les intrigues de leurs propres ministres, qui ne voulaient point d'un maître qui bornât leur pouvoir.
Malgré les vastes états que possède le grand-seigneur, il n'entre presque pour rien dans le système politique de l'Europe. Les Turcs sont pour ainsi dire inconnus dans la chrétienté, ou bien on ne les y connait que par une tradition ancienne et fausse, qui ne leur est point avantageuse. Si la Porte entretenait des ambassadeurs ordinaires dans toutes les cours ; que se mêlant des affaires, elle offrit sa médiation et la fit respecter ; que ses sujets voyageassent chez les étrangers, et qu'ils entretinssent un commerce réglé, il est certain qu'elle forcerait peu-à-peu les princes chrétiens à s'accoutumer à son alliance.
Mais il n'est pas vraisemblable que la Porte change de politique ; elle pensera toujours que son gouvernement doit avoir pour base l'ignorance et la misere des sujets.
L'Europe n'a pas lieu de craindre beaucoup les forces de la Porte. L'empereur, la Pologne, la Russie, et la république de Venise forment une barrière que les Turcs ne peuvent forcer. On ne saurait même douter que ces quatre puissances ne fussent en état de repousser le grand-seigneur en Asie, s'il était de l'intérêt des autres princes chrétiens, de leur laisser exécuter une pareille entreprise, ou si elles pouvaient elles-mêmes réunir leurs forces pour un semblable dessein. Ainsi la Porte conservera l'empire qu'elle a acquis en Europe, parce que d'ailleurs sa ruine agrandirait trop quelques puissances, surtout la Russie, et qu'il importe à tous les peuples qui font le commerce du levant, que la Grèce et les autres provinces de la domination ottomane, soient entre les mains d'une nation oisive, paresseuse, et qui ignore l'art de tirer parti des avantages que lui présente sa situation. (D.J.)