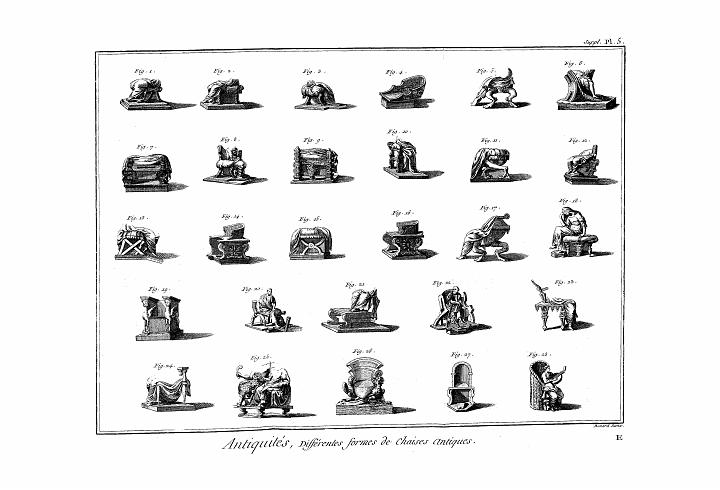S. f. (Mythologie) ce mot signifie en latin une nouvelle mariée ; mais c'est toute autre chose dans la Mythologie : les Poètes l'ont donné à des divinités subalternes, dont ils ont peuplé l'univers. Il y en avait qu'on appelait uranies ou célestes, qui gouvernaient la sphère du ciel ; d'autres terrestres ou épygies : celles-ci étaient subdivisées en nymphes des eaux, et nymphes de la terre.
Les nymphes des eaux étaient encore divisées en plusieurs classes ; les nymphes marines appelées océanides, néréides, et mélies. Les nymphes des fontaines, ou naïades, crénées, pégées : les nymphes des fleuves et des rivières, ou les potamides : les nymphes des lacs, étangs, ou lymnades.
Les nymphes de la terre étaient aussi de plusieurs classes ; les nymphes des montagnes qu'on appelait oréades, orestiades ou orodemniades : les nymphes des vallées, des bocages, ou les napées : les nymphes des prés ou limoniades : les nymphes des forêts, ou les dryades, et hamadryades. Tous ces noms marquaient le lieu de leur habitation.
Elles ont encore eu plusieurs autres noms : comme ionides, isménides, lysiades, thémistiades, et cent autres qu'elles tiraient du lieu de leur naissance, ou plutôt des lieux où elles étaient adorées, comme Pausanias et Strabon les interpretent.
On n'accordait pas tout à fait l'immortalité aux nymphes ; mais Hésiode les fait vivre quelques milliers d'années. On leur offrait en sacrifice du lait, de l'huile, et du miel, et on leur immolait quelquefois des chèvres.
Il n'est pas aisé de découvrir l'origine de l'existence des nymphes, et des fables qu'on a débitées sur leur compte. Cette idée des nymphes est peut-être venue de l'opinion où l'on était anciennement, que les âmes des morts erraient auprès des tombeaux, ou dans les jardins et les bois délicieux qu'elles avaient fréquentés pendant leur vie. On avait même pour ces lieux un respect religieux ; on y invoquait les ombres de ceux qu'on croyait y habiter ; on tâchait de se les rendre favorables par des vœux et des sacrifices, afin de les engager à veiller sur les troupeaux et sur les maisons. Meursius remarque que le mot grec nymphé, n'est autre que le mot phénicien néphas, qui veut dire âme ; et il ajoute que cette opinion, ainsi que plusieurs autres de ce temps-là, tiraient leur origine des Phéniciens.
Cette conjecture sur l'origine des nymphes peut encore être appuyée par l'idée que l'on avait que les astres étaient animés ; ce qu'on étendit ensuite jusqu'aux fleuves, aux fontaines, aux montagnes et aux vallées, auxquelles on assigna des dieux tutélaires.
Dans la suite on a pris pour des nymphes des dames illustres par quelques aventures ; c'est pour cela sans doute qu'Homère appelle nymphes, Phaètuse et Lampetie, qui gardaient en Sicîle les troupeaux du soleil.
On a même été jusqu'à honorer de simples bergeres du nom de nymphe, et tous les poètes anciens et modernes ont embelli leurs poésies de cette nouvelle idée. Mais comme Diodore rapporte que les femmes des Atlantides étaient communément appelées nymphes, il semble que c'est dans ce pays-là, que prit naissance l'opinion de l'existence de ces déesses ; parce qu'on disait que c'était dans les jardins délicieux de la Mauritanie tingitane, auprès du mont Atlas, qu'habitaient après leur mort les âmes des héros.
Quant aux métamorphoses de tant de personnes changées en nymphes, en naïades, en oréades, en néréïdes, en dryades, en hamadryades, etc. on peut penser que lorsque quelques dames illustres étaient enlevées à la chasse, qu'elles périssaient dans la mer, dans les bois ; la ressource ordinaire était de dire que Diane ou quelqu'autre divinité les avait changées en nymphes. Tel était la prétendue Egérie, cette célèbre nymphe que Numa Pompilius allait souvent consulter dans la forêt d'Aricie. Après la mort de ce prince, les Romains ne trouvant plus cette nymphe merveilleuse, mais seulement une fontaine, ils imaginèrent la métamorphose de la nymphe en fontaine.
Nous ne dirons rien ici de la belle description que fait Homère de l'antre des nymphes, ni de ces vers où Horace nous représente Bacchus instruisant ces déesses : vidi Bacchum docentem nymphas. On ne serait surement pas content des allégories que quelques auteurs y ont trouvées, et encore moins des obscénités qu'un philosophe stoïcien, homme grave et sérieux, a débitées sur ce sujet dans son héxaméron rustique.
Mais nous pouvons bien dire un mot de la fureur qu'éprouvaient ceux qui par hasard avaient Ve quelque nymphe dans le bain. Ovide lui-même craignait cet événement, comme il nous l'apprend au IV. liv. des Fastes, quand il dit,
Nec Dryadas, nec nos videamus labra Dianae,
Nec faunum medio cùm premit aura die.
" Jamais ne puissions-nous apercevoir Diane,
Ni les nymphes des bois, ni les faunes cornus,
Lorsqu'au milieu du jour ils battent la campagne ".
C'est à quoi Properce, liv. III. élég. XIIe fait allusion, lorsque décrivant la félicité des premiers siècles il dit :
Nec fuerat nudas paena videre deas.
" Alors pour avoir Ve quelques déesses nues,
On n'était point puni si rigoureusement ".
Ceux qui étaient épris de cette fureur des nymphes, s'appelaient en grec , en latin lymphatici. Les eaux, dit Festus, s'appellent lymphes, du nom de nymphes ; car on croyait autrefois que tous ceux qui avaient seulement Ve l'image d'une nymphe dans une fontaine, étaient épris de fureur le reste de leur vie. Les Grecs les nommaient nympholepti, et les latins lymphatici.
Plutarque dans la vie d'Aristide, dit : " la caverne des nymphes sphragitides est située à l'une des croupes du mont Cythéron ; il y avait anciennement un oracle, de l'esprit duquel plusieurs devenaient insensés ; ce qui les fit nommer nympholepti ". (D.J.)
NYMPHE, (Littérature) ce mot se prend quelquefois dans les auteurs grecs et latins pour une femme simplement. C'est ainsi que l'emploie Homère, Iliad. p. Ve 130. Callimaque, hymn. in Del. Ve 215. Hymn. in Apoll. Ve 90. etc. Ovide applique ce mot aux femmes des Grecs, lorsqu'il dit :
Grata ferunt nymphae pro salvis dona maritis.
C'est une chose assez commune dans les auteurs, d'appeler nymphes, les épousées et les nouvelles mariées. Elles portent le nom de nymphes, dit Phornutus, parce qu'alors elles paraissent en public pour la première fais, ayant été auparavant cachées, pour ainsi dire, dans leurs maisons. (D.J.)