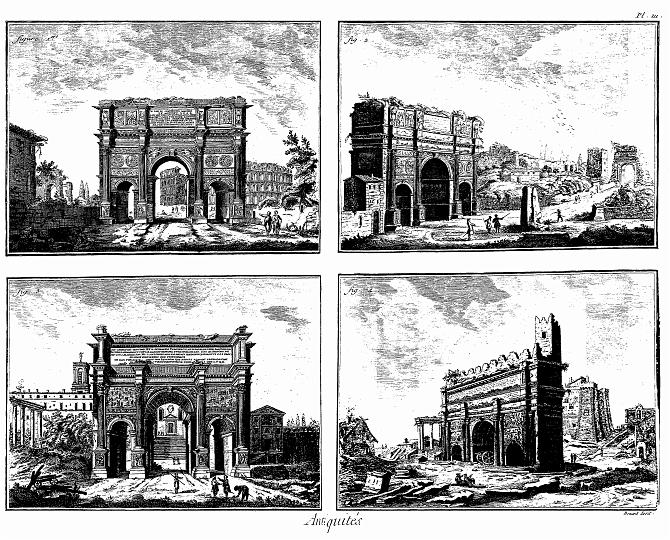(Mythologie) déesse de la sagesse et des arts, la seule des enfants de Jupiter, qui ait mérité de participer aux prérogatives attachées au rang suprême de la divinité. Tous les Mythologues, tous les Poètes en parlent ainsi. Il ne faudrait, pour s'en convaincre, que lire l'hymne de Callimaque sur les bains de Minerve, qui est une des plus belles pièces de l'antiquité. On voit dans cette hymne, que Minerve donne l'esprit de prophétie, qu'elle prolonge les jours des mortels à sa volonté, qu'elle procure le bonheur après la mort, que tout ce qu'elle autorise d'un signe de tête est irrévocable, et que tout ce qu'elle promet arrive immanquablement ; car, ajoute le poète, elle est la seule dans le ciel à qui Jupiter ait accordé ce glorieux privilège d'être en tout comme lui, et de jouir des mêmes avantages. En esset, quand les Mythologistes nous disent qu'elle était née de Jupiter sans le secours d'une mère, cela signifie que Minerve n'était autre chose que la vertu, la sagesse, le conseil du souverain maître des dieux.
Non-seulement elle daigna conduire Ulysse dans ses voyages, mais même elle ne refusa pas d'enseigner aux filles de Pandare l'art de représenter des fleurs et des combats dans les ouvrages de tapisserie, après avoir embelli de ses belles mains le manteau de Junon. De-là vient que les dames troyennes lui firent hommage de ce voîle précieux qui brillait comme un astre, et qu'Homère a décrit dans le sixième livre de l'Iliade.
Cette déesse ne dédaigne pas encore de présider au succès de la navigation ; elle éclaira les Argonautes sur la construction de leur navire, ou le bâtit elle-même selon Apollodore. Tous les Poètes s'accordent à nous assurer qu'elle avait placé à la proue le bois parlant, coupé dans la forêt de Dodone, qui dirigeait la route des Argonautes, les avertissant des dangers, et leur apprenant les moyens de les éviter. Sous ce langage figuré, on voit qu'il est question d'un gouvernail qu'on mit au navire Argo.
C'est en-vain que les anciens ont reconnu plusieurs Minerves : les cinq que Cicéron compte sont une seule et même personne, la Minerve de Saïs, c'est-à-dire, Isis même, selon Plutarque. Son culte fut apporté d'Egypte dans la Grèce, passa dans la Samothrace, dans l'Asie mineure, dans les Gaules, et chez les Romains. Saïs dédia la première à Minerve un temple magnifique, et disputa longtemps aux autres villes du monde la gloire d'encenser ses autels. Ensuite les Rhodiens se mirent sous la protection particulière de la déesse. Enfin elle abandonna le séjour de Rhodes pour se donner toute entière aux Athéniens, qui lui dédièrent un temple superbe, et célébrèrent en son honneur des fêtes dont la solennité attirait à Athènes des spectateurs de toute l'Asie ; c'est ce que prouvent les médailles, et Minerve fut surnommée .
Quoiqu'elle ne régnât pas aussi souverainement dans la Laconie que dans l'Attique, elle avait cependant son temple à Lacédémone comme à Athènes, dans un endroit élevé qui commandait toute la ville. Tyndare en jeta les fondements, Castor et Pollux l'achevèrent. Ils bâtirent aussi le temple de Minerve asia à leur retour de Colchos. Enfin entre les temples qui lui furent consacrés dans tout le pays ; celui qui portait le nom de Minerve ophtalmitide était le plus remarquable ; Lycurgue le dédia sous ce nom dans le bourg d'Alpium, parce que ce lieu-là lui avait servi d'azîle contre la colere d'Alcandre qui, mécontent de ses lais, voulut lui crever les yeux.
On donnait à Minerve, dans ses statues et dans ses peintures, une beauté simple, négligée, modeste, un air grave, noble, plein de force et de majesté. Son habillement ordinaire sur les médailles la représente comme protectrice des arts, et non pas comme la rédoutable Pallas qui, couverte du bouclier, inspire l'horreur et le carnage. Elle y parait vêtue du péplum, habillement si célèbre chez les Poètes et qui désigne le génie, la prudence et la sagesse. D'autres fois elle est représentée le casque en tête, une pique d'une main et un bouclier de l'autre, avec l'égide sur la poitrine ; c'est Pallas qu'on désigne ainsi.
Ces statues étaient anciennement assises, au rapport de Strabon ; on en voit encore dans cette attitude. La chouette et le dragon qui lui étaient consacrés accompagnent souvent ses images. C'est ce qui donna lieu à Démosthène, exilé par le peuple d'Athènes, de dire en partant que Minerve se plaisait dans la compagnie de trois vilaines bêtes : la chouette, le dragon et le peuple.
On sait que Minerve était honorée en différents endroits sous les noms de Minerve aux beaux yeux, Minerve aux yeux pers, Minerve inventrice, hospitalière, itonnienne, lemnienne, péonnienne, saronide, sténiade, suniade, et autres épithetes, dont les principales se trouvent expliquées dans l'Encyclopédie. (D.J.)