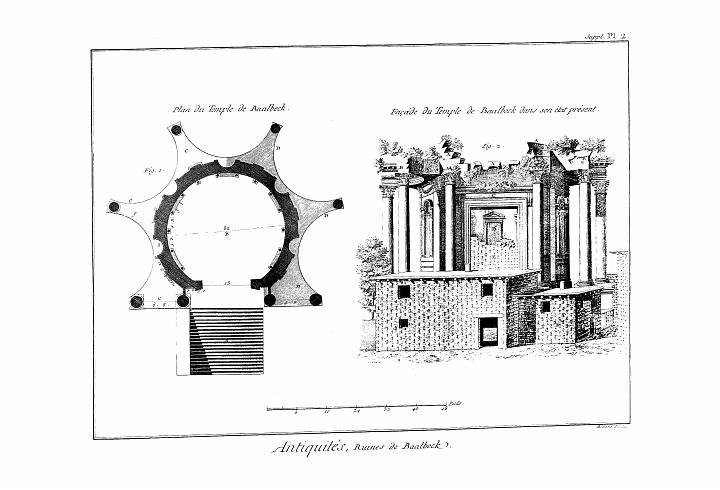S. m. (Mythologie) divinités domestiques des anciens payens, et dont il parait par leur mythologie qu'ils n'avaient pas des idées bien fixes, ce qu'on peut en recueillir de plus constaté, c'est que souvent ils les prenaient pour les âmes séparées des corps, d'autres fois pour les dieux infernaux, ou simplement comme les dieux ou les génies tutélaires des défunts.
Quelques anciens, au rapport de Servius, ont prétendu que les grands dieux célestes étaient les dieux des vivants ; mais que les dieux du second ordre, les manes en particulier, étaient les dieux des morts ; qu'ils n'exerçaient leur empire que dans les ténèbres de la nuit, auxquelles ils présidaient, ce qui, suivant eux, a donné lieu d'appeler le matin mane.
Le mot de manes a aussi été pris quelquefois pour les enfers en général, c'est-à-dire pour les lieux souterrains, où se devaient rendre les âmes des hommes après leur mort, et d'où les bonnes étaient envoyées aux champs Eliséens, et les méchantes au lieu des supplices appelé le Tartare.
C'est ainsi que Virgile dit :
Haec manes veniet mihi fama sub imos.
On a donné au mot de manes diverses étymologies : les uns le font venir du mot latin manare, sortir, découler, parce, disent-ils, qu'ils occupent l'air qui est entre la terre et le cercle lunaire, d'où ils descendent pour venir tourmenter les hommes ; mais si ce mot vient de manare, ne serait-ce point plutôt parce que les payens croyaient que c'était par le canal des manes que découlent particulièrement les biens ou les maux de la vie privée : d'autres le tirent du vieux mot latin manus, qui signifie bon, et suivant cette idée ils ne les considèrent que comme des divinités bienfaisantes qui s'intéressent au bonheur des humains, avec lesquels elles ont soutenu pendant leur vie des relations particulières, comme leurs proches ou leurs amis. Un auteur allemand, prévenu en faveur de sa langue, tire manes du vieux mot mann, homme, qu'il prétend être un mot des plus anciens, et qui vient de la langue étrusque. Or il dit que manes signifie des hommes par excellence, parce qu'il n'y a que les âmes véritablement vertueuses qui puissent espérer de devenir, après la mort de leurs corps, des espèces de divinités, capables de faire du bien aux amis de la vertu : mais la véritable étymologie du mot manes se trouve dans les langues orientales, et vient sans doute de l'ancienne racine moun, d'où se sont formés les mots chaldaïque et arabe, moan, man, hébreux, figura, similitudo, imago, phantasma, idea, species intelligibilis, forma imaginis cujusdam, dicitur enim de rebus, tam corporalibus quam spiritualibus, presertim de Deo. Vide Robert. Thes. ling. sanctae. Ce sont là tout autant de significations analogues aux idées qu'on se formait des manes, et aux diverses opérations qu'on leur attribuait.
De tous les anciens, Apulée est celui qui, dans son livre de Deo Socratis, nous parle le plus clairement de la doctrine des manes. " L'esprit de l'homme, dit-il, après être sorti du corps, devient une espèce de démon, que les anciens Latins appelaient lemures ; ceux d'entre les défunts qui étaient bons, et prenaient soin de leurs descendants, s'appelaient lares familiares ; mais ceux qui étaient inquiets, turbulents et malfaisants, qui épouvantaient les hommes par des apparitions nocturnes, s'appelaient larvae, et lorsqu'il était incertain ce qu'était devenue l'âme d'un défunt, si elle avait été faite lar ou larva, on l'appelait mane ", et quoiqu'ils ne déïfiassent pas tous les morts, cependant ils établissaient que toutes les âmes des honnêtes gens devenaient autant d'espèces de dieux, c'est pourquoi on lisait sur les tombeaux ces trois lettres capitales D. M. S. qui signifiaient diis manibus sacrum. Je ne sais où les compilateurs du célèbre dictionnaire de Trévoux ont appris qu'à Rome il était défendu d'invoquer les manes ; s'ils avaient consulté Festus, il leur aurait appris que les augures même du peuple romain étaient chargés du soin de les invoquer, parce qu'on les regardait comme des êtres bienfaisants et les protecteurs des humains ; il parait même que ceux qui avaient de la dévotion pour les manes, et qui voulaient soutenir avec eux quelque commerce particulier, s'endormaient auprès des tombeaux des morts, afin d'avoir des songes prophétiques et des révélations par l'entremise des manes, ou des âmes des défunts.
C'est ainsi qu'Hérodote, dans Melpomene, dit que les Nasamons, peuples d'Afrique, " juraient par ceux qui avaient été justes et honnêtes gens, qu'ils devinaient en touchant leurs tombeaux, et qu'en s'approchant de leurs sépulcres, après avoir fait quelques prières ils s'endormaient, et étaient instruits en songe de ce qu'ils voulaient savoir ".
Nous verrons dans l'article de l'ob des Hébreux, ce qui regarde l'évocation des morts et leur prétendue apparition.
Au reste, il parait clairement par une multitude d'auteurs, que les payens attribuaient aux âmes des défunts, des espèces de corps très subtils de la nature de l'air, mais cependant organisés, et capables des diverses fonctions de la vie humaine, comme voir, parler, entendre, se communiquer, passer d'un lieu à un autre, etc. il semble même que sans cette supposition nous ayons de la peine à nous tirer des grandes difficultés que l'on fait tous les jours contre les dogmes fondamentaux et consolans de l'immortalité de l'âme, et de la resurection des corps.
Chacun sait que l'idée de corps, ou du-moins de figures particulières unies aux intelligences célestes, à la divinité même, a été adoptée par ceux des chrétiens qu'on appelait Antropomorphytes, parce qu'ils représentaient Dieu sous la figure humaine.
Nous sommes redevables à cette erreur de je ne sais combien de belles peintures du Pere-éternel, qui ont immortalisé le pinceau qui les a faites, décorent aujourd'hui plusieurs autels, et servent à soutenir la foi et la piété des fidèles, qui souvent ont besoin de ce secours.