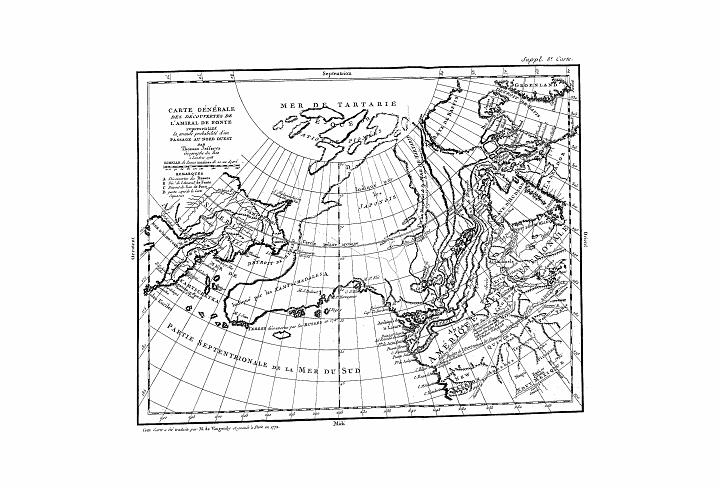(Mythologie) nom d'une fausse Divinité qu'on trouve parmi les dieux des Palmyréniens, sujets de la fameuse Zénobie. Il parait que cette partie de la Syrie adorait entre ses dieux, Aglibelus et Malachbelus ; c'est du moins ce qu'on peut conclure d'une grande table qui fut enlevée du temple du Soleil, lorsqu' Aurelien prit la ville de Palmyre, et sur laquelle se lisaient ces deux noms. Il y avait autrefois à Rome, dans les jardins qu'on appelait Horti carpenses, et qui sont aujourd'hui ceux des princes Justiniani, près de S. Jean-de-Latran, un beau monument, qui avait été apporté de Palmyre à Rome. M. Spon a publié en 1685 ce bas-relief, avec l'inscription qui l'accompagne. Elle est en langue palmyrénienne, qui n'est plus connue, et en grec, qui contient apparemment la même chose. On trouvait déjà dans le trésor des antiquités de Gruterus l'inscription toute entière, mais sans les figures. Le R. P. dom Bernard de Montfaucon s'en est procuré une copie beaucoup plus exacte, et mieux dessinée, que celle qui avait paru dans d'autres recueils d'antiquités ; c'est celle que nous avons sous les yeux ; elle diffère un peu de celle de Spon : en voici une traduction très-fidèle. " Titus Aurelius Heliodorus Adrianus, palmyrénien, fils d'Antiochus, a offert et consacré, à ses dépens, à Aglibelus et à Malachbelus, dieux de la patrie, ce marbre, et un signe ou petite statue d'argent, pour sa conservation, et pour celle de sa femme et de ses enfants, en l'année cinq cent quarante-sept, au mois Peritius ".
Le bas-relief est ce qu'on appelle un ex voto. Il représente le frontispice d'un temple, soutenu de deux colonnes. On y voit deux figures de jeunes personnes, au milieu desquelles est un arbre que quelques antiquaires ont pris mal-à-propos pour un pin, mais qui est surement un palmier, ce qui caractérise la ville de Palmyre, qui s'appelait aussi Tadmor, ou Tamor, ce qui est la même chose ; car thamar en hébreu signifie palme. Au côté droit de cet arbre, est le dieu Aglibelus, sous la figure d'un jeune homme, vêtu d'une tunique relevée par la ceinture, en sorte qu'elle ne descend que jusques au-dessus du genou, et qui a par-dessus une espèce de manteau ; tenant, de la main gauche, un petit bâton fait en forme de rouleau ; le bras droit, dont peut-être il tenait quelque chose, est cassé. A l'autre côté est le dieu Malachbelus, qui représente aussi un jeune homme, vêtu d'un habillement militaire, avec le manteau sur les épaules, une couronne radiale à la tête, et ayant derrière lui un croissant, dont les deux cornes débordent des deux côtés.
Le savant et judicieux M. l'Abbé Banier, dans son excellent ouvrage de la Mythologie et des fables expliquées par l'histoire, tom. III. chap. VIIe p. 107. n'est pas satisfaisant sur cet article ; il s'en rapporte à l'idée de M. Spon, dont l'opinion, dit-il, n'a point été contredite : mais assurément il ne s'ensuit pas de-là qu'elle ne puisse l'être. Quelques auteurs, dit M. Spon, prétendent que ces deux figures représentent le soleil d'hiver et d'été ; mais comme l'un des deux a derrière lui un croissant, il vaut mieux croire que c'est le soleil et la lune. Chacun sait, comme le remarque Spartien, et d'autres auteurs, que les Payens avaient leur dieu Lunus ; et parmi les médailles de Seguin, il y en a une qui représente ce dieu Lunus avec un bonnet arménien.
Pour Aglibelus, ajoute M. Banier, il n'est pas douteux que ce ne soit le Soleil, ou Bélus ; car les Syriens peuvent fort bien avoir prononcé ainsi ce nom, que d'autres appelaient Baal, Belenus, Bel ou Belus. Le changement de l'e en o est peu de chose dans les différents dialectes d'une langue ; mais le mot agli sera inintelligible, à moins qu'on n'admette la conjecture du savant Malaval, qui prétend que ce nom signifie la lumière qu'envoie le soleil, fondé sur l'autorité d'Hesichius, qui met parmi les épithetes du soleil, celle d' ; or il n'est pas étonnant que les Grecs aient prononcé Aglibelus, au lieu d'Egletes Belos. Il appuie ce sentiment sur le culte particulier qu'on sait que les Palmyréniens rendaient au soleil.
Pour ce qui est de Malachbelus, ce mot est composé de deux autres ; savoir, malach, qui veut dire roi, et baal, seigneur. Ce dieu étant représenté avec un croissant et une couronne, il est certain, prétend M. Spon, que c'est la Lune, ou le dieu Lunus, l'Ecriture-sainte désignant souvent la lune par l'épithète de reine du ciel ; ainsi le prophète Jérémie, condamnant l'usage d'offrir des gâteaux à cette déesse, s'exprime ainsi : Placentas offert reginae coeli.
M. Jurieu pense que Aglibelus signifie l'oracle de Bel, dérivant agli du mot hébreu revelavit. Une attention plus particulière au mot Aglibelus et aux divers attributs des deux figures du monument, aurait donné à ces savants une idée plus juste, et les eut conduit à trouver dans ces deux figures les deux points du jour, le matin et le midi ; l'une signifie gutta, ou uligo, humor quae fit ex rore liquefacto ; ce mot se trouve dans ce beau passage du livre de Job, chap. xxxviij. Ve 28. La pluie n'a-t-elle point de père ? ou qui produit les gouttes de la rosée ? Aglibelus est donc le dominateur des gouttes, le seigneur de la rosée, qui est dans la nature un des plus grands principes de végétation et de fécondité ; le rouleau qu'il tient à la main, sont les cieux de nuit, éclairés et embellis par une multitude d'astres, que le point du jour fait disparaitre, et qu'il roule, suivant l'expression du psalmiste, figure très-belle, empruntée dans l'énergie du style oriental ; et si le bras droit d'Aglibelus ne manquait pas, on verrait, sans doute, qu'il tenait une coupe, ou qu'il exprimait une espèce d'éponge, ou de nue, dont il faisait distiller la rosée ; peut-être même avait-il dans la main droite l'étoîle du matin, conjectures que justifient un grand nombre d'autres figures analogues, qu'on trouve dans des recueils d'antiquités. La tunique relevée par la ceinture, et qui ne descend que jusqu'au genou, sert encore à confirmer notre explication, puisque c'est la précaution que prenaient sans doute les anciens, habillés de longues robes, et que prennent encore nos femmes de la campagne, lorsqu'elles vont à l'ouvrage, avant que la rosée soit dissipée.
Quant à Malachbelus, l'on ne peut assez s'étonner que M. Spon, et M. l'Abbé Banier, après lui, aient pu, malgré son nom, qui semble l'élever au-dessus de toutes les autres divinités, et les divers attributs qui lui sont donnés dans le monument de Palmyre, et qui soutiennent ses prérogatives ; que ces MM. dis-je, aient pu le postposer en quelque sorte à Aglibelus ; faire de celui-ci le soleil, et de Malachbelus la lune. Malachbelus est composé de deux mots : malac, moloch ou molech, suivant les divers dialectes, signifie roi, belus, ou bahal vient de dominer, être maître : ainsi Malachbelus est un roi dominateur et maître ; ce qui nous donne l'idée d'un être suprême, du plus grand des dieux : aussi il parait dans le monument palmyrénien, avec un éclat et une distinction particulière, vêtu d'un habillement militaire, le manteau royal sur les épaules, la tête couronnée ; cette couronne radiale marque l'éclat du soleil dans son midi ; et s'il a derrière lui un croissant, dont les deux cornes débordent des deux côtés, c'est pour marquer l'empire que le soleil a sur la lune, qu'il fait disparaitre par sa présence.
Au reste, Aglibelus occupant la droite dans ce monument, nommé avant Malachbelus dans l'inscription, justifie encore notre opinion, parce que le point du jour précède le midi. Le pin, ou plutôt le palmier qui est entre les deux figures, nous fait connaître que le dévot palmyrénien vivait à la campagne, ou du moins s'intéressait à l'agriculture, et qu'implorant le secours des dieux pour sa conservation, et celle de sa famille, il s'adressait à ceux qui influaient le plus sur la fertilité de la terre.
C'est à ces divinités syriennes que nous devons rapporter le surnom du dernier empereur romain de la famille des Antonins ; il s'appelait Marc-Aurele Antoninus Varius, surnommé Elagabale, parce qu'il avait été sacrificateur de ce dieu, dont les divers auteurs écrivent le nom avec quelques petites différences ; les uns, comme Herodianus, Alagabalus ; d'autres, comme Capitolinus, Elagabalus ; quelques-uns, comme Lampridius, Helaeogabalus ; mais les Grecs et les Latins, pour l'ordinaire, Heliogabalus.
Le mot de Bahal paraissant dans ces divers noms, c'est de l'intelligence de ce mot que dépend la connaissance de ces divinités, et de Malachbelus en particulier. Il n'y a pas de faux dieu plus célèbre dans l'Ecriture-sainte que Bahal ; c'est qu'il était, sans doute, l'un des principaux objets de la religion des peuples qu'avaient dépossédés les Hébreux, ou des Hordes qui avoisinaient la Palestine. C'est surtout dans l'histoire de Gédéon qu'il est extrêmement parlé de Bahal. Juges, 5. Ve 25. Gédéon démolit son autel, et coupa le bocage qui était auprès ; les gens du lieu s'en mirent fort en colere, et voulurent le faire mourir ; mais Joas, père de Gédéon, le défendit ; et plus philosophe qu'on ne l'était dans ce temps-là, et qu'on ne l'a été depuis, il dit fort judicieusement : Si Bahal est un dieu, qu'il prenne la cause pour lui-même, de ce qu'on a démoli son autel. Et il l'appela du nom de son fils, Jetabbahal, qui signifie, que Bahal prenne querelle, ou qu'il plaide et dispute ; et c'est sans doute là le Jerombahal duquel le fameux Sanchoniaton dit avoir emprunté une partie des choses qu'il rapporte, , ou selon Porphire, . Jézabel, femme de l'impie Achab, roi d'Israèl, et fille d'Ethbahal, roi des Sydoniens, apporta avec elle à Samarie, le culte de Bahal, et sut persuader à son époux de le préférer à celui de l'Eternel, (I. liv. des Rais, chap. XVIIIe Ve 4.) dont tous les prophetes furent exterminés, à la réserve d'Elie, et de cent autres, qu'à l'insu même de ce grand prophète, qui se croyait seul en Israèl, le pieux Abdias (v. 22.) avait cachés dans deux cavernes, et qui échappèrent ainsi à la fureur d'Achab et de Jézabel. Au reste, ce couple impie détruisait d'un côté pour édifier de l'autre ; car ils consacrèrent plus de 450 prophetes au service du nouveau Dieu, et 400 à celui de ces bocages et hauts lieux qu'avait fait planter Jézabel. Dans un état aussi petit que Samarie, et dans un temps où l'esprit humain emporté à tous vents de doctrine, se livrait à toute sorte de culte, c'est sans doute consacrer beaucoup trop de ministres aux solennités et aux mystères du culte d'un seul Dieu ; mais il faut croire qu'alors ceux qui servaient aux autels, n'étaient pas, comme parmi nous, en pure perte pour la société civile, et que du moins on pouvait être prophète, et donner des sujets à l'état. Quoi qu'il en sait, ce peuple de prophetes, et la cruelle Jézabel, leur protectrice, furent étrangement humiliés dans le fameux procès qu'ils eurent à soutenir avec Elie, pour savoir qui était le vrai Dieu, l'Eternel ou Bahal. Elie demande qu'on assemble (I. liv. des Rais, chap. XVIIIe Ve 19.) les 850 prophetes de Bahal et des bocages, qui mangeaient à la table de Jézabel ; il leur propose de sacrifier des victimes sans feu, (v. 23.) lui, sur un autel qu'il bâtirait à son Dieu ; eux, sur l'autel de Bahal ; et que celui qui ferait bruler ses victimes, en faisant tomber le feu du ciel pour les consumer, serait estimé le véritable Dieu. La proposition fut acceptée ; l'enthousiasme s'en mêlait sans doute ; il est rare que le don de prophétie en soit exempt.
I. Rais, XVIIIe Ve 26. Ils prirent donc une jeune génisse qu'on leur donna, et l'apprêtèrent, et invoquèrent le nom de Bahal, depuis le matin jusqu'à midi, disant : Bahal, exauce-nous ; mais il n'y avait ni voix, ni réponse, et ils sautaient d'outre en outre par-dessus l'autel qu'on avait fait, etc. &c. Ils criaient donc à haute voix, et se faisaient des incisions avec des couteaux et des lancettes, selon leur coutume, tant que le sang coulait. Ve 27. Elie, de son côté, se mocquait d'eux, et disait : Criez à haute voix, car il est dieu ; mais il pense à quelque chose, ou il est occupé à quelque affaire, ou il est en voyage ; peut-être qu'il dort, et il se réveillera.
v. 30. et seq. L'Eternel soutint sa cause, et fit glorieusement triompher son prophète, qui avait imploré avec ardeur son puissant secours. A peine Elie eut-il élevé son autel, qu'après plusieurs ablutions et aspersions réiterées, tant sur la victime, que sur le bois qui devait lui servir de bucher, au point que les eaux allaient à l'entour de l'autel, et qu'Elie remplit même le conduit d'eau, le feu de l'Eternel, un feu miraculeux descendit, consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poudre, réduisit tout en cendres, et huma toute l'eau qui était au conduit.
Dans une sécheresse des plus extraordinaires, et telle, que (O tempora ! O mores !) le roi Achab, pour ne pas laisser dépeupler son pays de bêtes, I. Rais, XVIIIe Ve 3. 5. 6. parcourait ses états à la tête de ses chevaux, ânes et mulets, pour chercher vers les fontaines d'eaux et torrents, de l'herbe pour leur sauver la vie ; son favori, son premier ministre Abdias faisant la même chose de son côté ; dans de telles circonstances, dis-je, l'eau qu'Elie prodiguait dans ce sacrifice extraordinaire, ne fut sans doute pas ce que les spectateurs regrettèrent le moins. Il est vrai que le peuple s'étant prosterné, et ayant reconnu, après le sacrifice, l'Eternel pour le seul vrai Dieu, les prophetes de Bahal tous égorgés par l'ordre d'Elie, ce grand prophète obtint de la bonté du Très-Haut une pluie abondante.
II. Rais, chap. XIe Ve 17. 18. La malheureuse Athalie, mère de Joas, avait établi dans Jérusalem le culte du même dieu Bahal ; mais Joas, sous la conduite et par l'ordre du souverain sacrificateur Jehojada, détruisit cette idole, et tout le peuple du pays entra dans la maison de Bahal, et ils la démolirent, ensemble ses autels, et brisèrent entièrement les images ; ils tuèrent aussi Mathan, sacrificateur de Bahal, devant ses autels.
Au reste, Bal, Baal, Bahal, Behel, Bel, Belus, sont une seule et même divinité, dont le nom est varié par les divers dialectes dans lesquels il est employé. Connu des Carthaginois, le nom de ce faux dieu, suivant l'usage des anciens, se remarque dans les noms de leurs princes, ou généraux ; ainsi, en langue punique, Annibal signifie exaucé ou favorisé par Bahal ; Asdrubal, recherché par Bal, Adherbal, aidé par le Dieu Bahal.
J'observe que l'Ecriture-sainte parle souvent de ce faux dieu au pluriel, les Bahals ou Bahalins, je serais donc assez porté à croire que cela est dans le génie des langues orientales ; car quelque soin que prenne l'Etre suprême de rappeler sans cesse les hommes à l'unité de son essence adorable, très-souvent les auteurs sacrés le nomment au pluriel ; peut-être aussi qu'il est parlé des Bahals ou Bahalins, suivant les diverses statues ou idoles qui avaient accrédité sa dévotion ; c'est ainsi que Jupiter reçoit les différents noms de Olympien, Dodonéen, Hammon, Feretrien, etc. Et sans aller plus loin, n'avons-nous pas la même Notre-Dame qui s'appelle en un lieu de Montferrat, ici de Liesse, là de Lorette, ailleurs des Ardilleres, d'Einsiedeln, etc. suivant les images miraculeuses qui lui ont fait élever des autels, ou consacrer des dévotions particulières. Mais ce qui est digne de remarque, c'est que très-souvent les 70 Interpretes désignent ce dieu Bahal, comme une déesse, aussi bien que comme un dieu, et construisent ce mot avec des articles féminins, comme S. Jean, VIIe 4. , ils détruisirent les Bahalines. Jer. IIe 18. XIe 13. xix. 5. xxxij. 33.
Au reste pour peu qu'on soit au fait de la Mythologie, on sait que les Payens croyaient honorer leurs dieux, en leur attribuant les deux sexes, et les faisant hermaphrodites, pour exprimer la vertu générative et féconde de la divinité. Aussi Arnobe remarque que dans leurs invocations, ils avaient accoutumé de dire, soit que tu sois dieu, soit que tu sois déesse ; nam consuetis in precibus dicère, sive tu deus, sive tu dea, quae dubitationis exceptio dare vos diis sexum, disjunctione ex ipsa declarat. Arnob. contra Gent. lib. III.
Vid. Aul. Gel. lib. II. 23. Dans les hymnes attribuées à Orphée, parlant à Minerve, il dit : , tu es mâle et femelle. Chacun sait la pensée de Plutarque dans son traité d'Isis et d'Osiris : , or Dieu qui est une intelligence mâle et femelle, étant la vie et la lumière, a enfanté un autre verbe qui est l'intelligence créatrice du monde.
Vénus même, la belle Vénus a été faite mâle et femelle. Macrobe, saturn. III. dit qu'un poète nommé Coelius, l'avait appelée pollentemque deum Venerem, non deam, et que dans l'île de Chypre, on la peignait avec de la barbe : sic poèsis ut pictura, &c.
Comme les Peintres et les Poètes donnent toujours à leurs héroïnes les traits et la ressemblance de leurs maîtresses, sans doute que le premier peintre Cypriot, qui s'avisa de peindre Vénus barbue, aimait une belle au menton cotonné et velu, telles qu'on en voit qui ne laissent pas d'être appétissantes et très-aimables. Nous connaitrons plus particulièrement ce que les Orientaux adoraient sous le nom de Bahals, si nous nous rappelons que Moyse, dans l'histoire de la création, dit que Dieu fit les deux grandes lumières, le soleil et la lune, pour dominer sur le jour et la nuit ; et c'est pour cela sans doute, que ces deux astres ont été appelés Bahalins, les dominateurs ; que Malachbelus soit le soleil, c'est ce dont on conviendra sans peine, si considérant que les luminaires, les astres en général, les planètes en particulier ayant été les premiers objets de l'idolâtrie des anciens peuples, le soleil a dû être regardé comme le roi de ces prétendues divinités ; et certes, tant de raisons parlent en sa faveur, que l'on conçoit sans peine, j'ai presque dit, que l'on excuse le culte qu'ont pu lui rendre les peuples privés de la révélation.
Unique et brillant soleil, s'écrie Zaphy (manuscript. Lugd. in Batavis, Zaphy), poète arabe, unique et brillant soleil, source de vie, de chaleur et de lumière, je n'adorerais que toi dans l'univers, si je ne te considérais comme l'esclave d'un maître plus grand que toi, qui a su t'assujettir à une route de laquelle tu n'oses t'écarter ; mais tu es et seras toujours le miroir dans lequel je vois et connais ce maître invisible et incompréhensible. Nous trouvons dans Sanchoniaton, le théologien des anciens Phéniciens, une preuve sans réplique que Malachbelus était le soleil. Les Phéniciens, dit-il, c'est-à-dire ceux de Tyr, de Sidon et de la côte, regardaient le soleil comme l'unique modérateur du ciel ; ils l'appelaient Beelsamein ou Baal-samen, qui signifie, seigneur des cieux. Sur quoi j'observe que l'Ecriture ne parle presque jamais de l'idole Bahal, qu'elle n'y joigne Astoreth, et toute l'armée des cieux ; c'est ainsi qu'il est dit de Josias, II. Rais, xxiij. 5. qu'il abolit aussi ceux qui faisaient des encensements à Bahal, à la lune, aux astres, et à toute l'armée des cieux, c'est-à-dire au soleil, à la lune et aux étoiles.
Servius, sur le premier livre de l'Enéide, dit que le Bahal des Assyriens est le soleil : Linguâ punicâ deus dicitur Bal, apud Assyrios autem Bel dicitur, quadam sacrorum ratione et saturnus et sol.
La ville de Tyr était consacrée à Hercule, c'était la grande divinité de cette ville célèbre dans l'antiquité. Or, si on consulte Hérodote, et si l'on doit et peut l'en croire, on ne peut raisonnablement douter que cet Hercule tyrien ne soit le Bahal des Orientaux, c'est-à-dire le soleil même. Hérod. liv. II. pag. 120. Hérodote dit s'être transporté à Tyr tout exprès pour connaître cet Hercule ; qu'il y avait trouvé son temple d'une grande magnificence, et rempli des plus riches dons, entr'autres une colonne d'émeraudes qui brillait de nuit, et jetait une grande lumière. Si le fait est vrai, ne serait-ce point parce que les sacrificateurs avaient ménagé dans le milieu de la colonne, un vide pour y placer un flambeau ? Quoi qu'il en sait, cela était visiblement destiné à représenter la lumière du soleil, qui brille en tout temps. Hérodote ajoute que par les entretiens qu'il eut avec les sacrificateurs, il fut persuadé que cet Hercule tyrien était infiniment plus ancien que l'Hercule des Grecs ; que le premier était un des grands dieux, que l'Hercule grec n'était qu'un héros, ou demi-dieu.
Le nom même d'Hercule prouverait que c'est le soleil ; ce mot est pur Phénicien. Heir-coul signifie, dans cette langue, illuminat omnia. Je ne voudrais cependant pas décider que jamais le soleil ait porté à Tyr ou Carthage, le nom d'Hercule ; je pense même que non, et qu'on l'appelait Baal ou Moloch, ou, à l'imitation de ceux de Tadmor, Malachbelus ; mais je ne doute point que parmi les éloges ou attributs de Bahal, on ait mis celui de Heir-coul, c'est-à-dire, illuminant toutes choses.
Les Romains, fort portés à adopter tous les dieux étrangers, avec lesquels ils faisaient connaissance, voyant que les Carthaginois donnaient à leur Baal le titre et l'éloge de Heir-coul, en ont fait leur exclamation, me Hercle ! et me Hercule ! et même leur Hercule ; et de-là est venu que celui que les Tyriens, et leurs enfants les Carthaginois, appelaient Bahal, les Latins l'ont appelé Hercules.
Saturn. lib. I. cap. xx. Macrobe parait être dans l'idée qu'Hercule était le soleil, lorsque faisant uniquement attention à l'étymologie grecque, il dit : et revera Herculem solem esse, vel res nomine claret ; Hercules enim quid aliud est nisi heras, id est, aeris cleos, id est gloria. Il ajoute plusieurs raisons très-fortes pour prouver la même thèse, c'est qu'Hercule est le soleil. Les douze travaux d'Hercule n'auraient-ils point été inventés sur les douze constellations du zodiaque, que le soleil parcourt tous les ans ? Le célèbre Vossius a mis dans le plus grand jour ce système, qu'Hercule est le soleil, vraisemblablement adoré à Palmyre sous le nom de Malachbelus ; le soleil y avait un temple très-fameux. Guillaume Hallifax, gentilhomme anglais, a examiné avec soin les ruines superbes de ce somptueux édifice : on peut voir la description magnifique qu'il en a faite dans les Transactions philosophiques en l'année 1695. Deux gentilshommes de la même nation, ayant avec eux un peintre fort habile, ont entrepris le voyage de Palmyre, et ont donné au public, depuis quelques années, les planches gravées de ce qui reste du superbe temple du soleil ; ce qui annonce un bâtiment plus grand, plus magnifique, qu'on n'aurait dû l'attendre du siècle dans lequel il fut élevé, et mieux entendu qu'on ne pouvait l'espérer des mains barbares qui y travaillèrent.