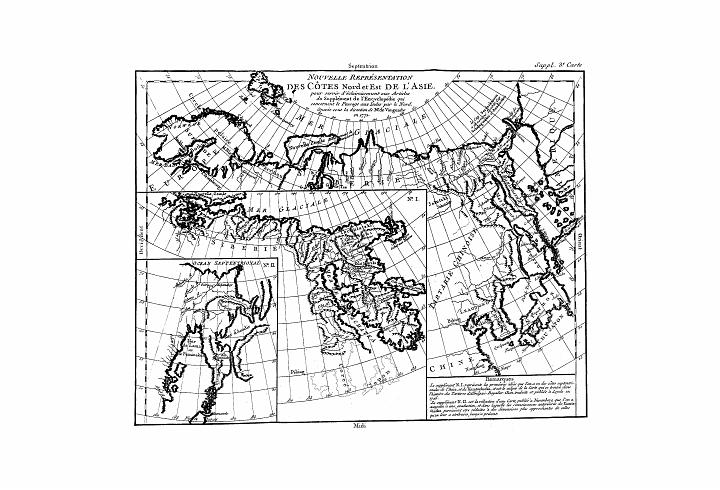S. f. (Mythologie, Littérature, Antiquité et Médailles) déesse du paganisme que les Grecs appellent ; et ce nom fut appliqué à plusieurs endroits qu'on lui consacra.
Junon, suivant la fable, était la fille de Saturne et de Rhée, sœur et femme de Jupiter, et par conséquent reine des dieux. Aussi sait-elle bien le dire elle-même :
Ast ego quae divum incedo regina, Jovisque
Et soror et conjux.
Personne n'ignore ce qui regarde sa naissance, son éducation, son mariage avec Jupiter, son mauvais ménage avec lui, sa jalousie, ses violences contre Calixte et la nymphe Thalie, son intendance sur les noces, les couches, et les accidents naturels des femmes ; les trois enfants, Hebé, Mars, et Vulcain, qu'elle conçut d'une façon extraordinaire, la manière dont elle se tira des poursuites d'Ixion, le sujet de sa haine contre Paris, et ses cruelles vengeances à ce sujet, qui s'étendirent si longtemps sur les Troie.s et le pieux Enée. Enfin l'on sait qu'elle prit le sage parti de protéger les Romains, en favorisant cette suite de leurs victoires, qui devaient les rendre les maîtres du monde, et que Jupiter avait prédites.
Quin aspera Juno,
Quae mare, nunc terrasque, metu coelumque fatigat,
Consilia in meliùs referet, mecumque fovebit
Romanos rerum dominos gentemque togatam.
Aenéid. lib. I. Ve 279.
Les amours de cette déesse pour Jason, n'ont pas fait autant de bruit que ses autres aventures ; cependant à quelque diversité près dans le récit, Pindare, Servius, Hygin, Apollonius de Rhodes, et Valerius Flaccus, ne les ont pas obmises.
Le prétendu secret qu'elle avait de recouvrer sa virginité, en se lavant dans la fontaine Canathus au Péloponnèse, n'a été que trop brodé par nos écrivains modernes. Pausanias dit seulement que les Argiens faisaient ce conte, et le fondaient sur la pratique de leurs cérémonies dans les mystères de la déesse.
Mais ce qui nous intéresse extrêmement, comme philosophes et comme littérateurs, c'est que de toutes les divinités du Paganisme, il n'y en a point eu dont le culte ait été plus grand, plus solennel, et plus général. La peinture des vengeances de Junon, dont les théâtres retentissaient sans-cesse, inspira tant de craintes, d'alarmes, et de respect, qu'on n'oublia rien pour obtenir sa protection, ou pour apaiser une déesse si formidable, quand on crut l'avoir offensée.
Les honneurs religieux de tous genres qu'on lui rendit en Europe, passèrent en Afrique, en Asie, en Syrie, et en Egypte. On ne trouvait par-tout que temples, autels, et chapelles dédiées à Junon ; mais elle était tellement vénérée à Argos, à Samos, à Stymphale, à Olympie, à Carthage, et en Italie, qu'il est nécessaire de nous arrêter beaucoup au tableau qu'en fait l'Histoire, concurremment avec les Poètes.
Les Argiens prétendaient que les trois filles du fleuve Astérion, avaient nourri la sœur et l'épouse de Jupiter. L'une de ces trois filles s'appelait Eubée ; son nom fut donné à la montagne sur laquelle paraissait de loin le temple de Junon, dont Eupoleme avait été l'architecte. Son fondateur était Phoronée fils d'Inachus, contemporain d'Abraham, ou peu s'en faut.
En entrant dans le temple, dit Pausanias, on voit assise sur un trône la statue de la déesse, d'une grandeur extraordinaire, toute d'or et d'ivoire. Elle a sur la tête une couronne que terminent les Graces et les Heures ; elle tient une grenade d'une main, et de l'autre un sceptre, au bout duquel est un coucou.
Les regards des spectateurs se portaient ensuite sur la représentation en marbre de l'histoire de Biton et Cléobis, deux frères recommandables par leur piété envers leur mère, et qui méritaient les honneurs héroïques. On conservait dans ce même temple le plus ancien simulacre de Junon, qui était de poirier sauvage.
Le vestibule du temple offrait à la vue les statues de toutes les prêtresses de la déesse, prêtresses si respectées dans Argos, que l'on y comptait les années par celles de leur sacerdoce. Ces prêtresses avaient le soin de couvrir l'autel de la divinité d'une certaine herbe qui venait sur les bords de l'Astérion ; l'eau dont elles se servaient pour les sacrifices, et les mystères secrets, se prenait dans la fontaine Eleuthérie, et il n'était pas permis d'en puiser ailleurs : les scholiastes de Pindare nous instruisent des jeux que les Argiens faisaient en l'honneur de Junon.
Les Samiens se vantaient que la reine des dieux avait pris naissance dans leur île ; qu'elle y avait été élevée ; que même ses noces avec Jupiter avaient été célébrées dans le temple qui lui était consacré, et qui a fait tant de bruit dans le monde. Voici ce qu'en dit M. de Tournefort, après son séjour sur les lieux.
Environ à 500 pas de la mer, et presque à pareille distance de la rivière Imbrasus, vers le cap de Cora, sont les ruines du fameux temple de Junon, la protectrice de Samos. Les plus habiles papas de l'île connaissent encore cet endroit sous le nom de temple de Junon. Menodote Samien, cité dans Athenée, comme l'auteur d'un livre qui traite de toutes les curiosités de Samos, assure que ce temple était le fruit des talents de Caricus et des nymphes : car les Cariens ont été les premiers possesseurs de cette ile.
Pausanias dit qu'on attribuait cet ouvrage aux Argonautes qui avaient apporté d'Argos à Samos une statue de la déesse, et que les Samiens soutenaient que Junon était née sur les bords du fleuve Imbrasus, (d'où lui vint le nom d'Imbrasia), et sous un de ces arbres, que nous appelons agnus castus : on montra longtemps par vénération ce pied d'agnus castus, dans le temple de Junon.
Pausanias prouve aussi l'antiquité de ce temple, par celle de la statue de la déesse, qui était de la main de Smilis, sculpteur d'Egine, contemporain de Dédale. Athenée sur la foi du même Menodote, dont nous venons de parler, n'oublie pas un fameux miracle arrivé, lorsque les Athéniens voulurent enlever la statue de Junon : ils ne purent jamais faire voile, qu'après l'avoir remise à terre, prodige qui rendit l'île plus célèbre et plus fréquentée.
Le temple dont il s'agit ici, fut brulé par les Perses, et on en regardait encore les ruines avec admiration : mais on ne tarda pas à le relever, et il fut rempli de tant de richesses, qu'on ne trouva plus de place pour les tableaux et pour les statues. Verrès, revenant d'Asie, ne craignit point le sort des Athéniens ; il ne fit pas scrupule de piller ce temple, et d'en emporter les plus beaux morceaux ; les Pirates n'épargnèrent pas davantage cet édifice du temps de Pompée.
Strabon l'appelle un grand temple, non-seulement rempli de tableaux, mais dont toutes les galeries étaient ornées de pièces fort anciennes. C'est sans-doute parmi ces pièces, qu'on avait exposé le fameux tableau qui peignait les premières amours de Jupiter et de Junon, d'une manière si naturelle, qu'Origène ne put se dispenser de le reprocher aux Gentils.
Il y avait outre cela dans le temple de Junon à Samos, une cour destinée pour les statues, parmi lesquelles on en voyait trois colossales de la main de Myron, portées sur la même base. Marc-Antoine les avait fait enlever ; mais Auguste rendit aux Samiens celles de Minerve et d'Hercule, et se contenta d'envoyer celle de Jupiter au capitole, pour être placée dans une basilique qu'il fit bâtir.
De tant de belles choses du temple de Junon Samienne, M. de Tournefort ne trouva sur la fin du dernier siècle, que deux morceaux de colonnes, et quelques bases d'un marbre exquis. Peu d'années auparavant, les Turcs s'imaginant que la plus haute était pleine d'or et d'argent, tentèrent de l'abattre à coups de canon qu'ils tiraient de leurs galeres. Les boulets firent éclater quelques tambours, dérangèrent les autres, et en mirent une moitié hors de leur situation.
On ne peut plus reconnaître le plan de cet édifice qui, selon Hérodote, était la seconde merveille de Samos, le temple le plus spacieux qu'il eut Ve ; et nous ignorerions sans lui, le nom de l'architecte ; c'était un Samien appelé Rhaecus.
Il ne faut pas s'en tenir au dessein de ce temple, qui se trouve sur les médailles antiques, parce qu'on y représentait souvent différents temples sous la même forme, comme par exemple, le temple dont nous parlons, et celui d'Ephèse, qui vraisemblablement n'étaient pas du même dessein.
Pausanias, que je cite souvent, fait mention de trois temples de Junon dans la ville de Stymphale en Arcadie ; le premier était appelé le temple de Junon fille ; le second le temple de Junon mariée ; et le troisième le temple de Junon veuve. Ces trois temples lui furent érigés par Temenus, et le dernier fut bâti, lorsque la déesse alla, dit-on, se retirer à Stymphale, après son divorce avec Jupiter.
Cette reine des dieux recevait aussi les plus grands honneurs à Olympie : il y avait dans cette dernière ville seize dames préposées aux jeux que l'on y célebrait à sa gloire tous les cinq ans, et dans lesquels on lui consacrait un péplus, espèce de robe sans manches, et toute brochée d'or. Trais classes de jeunes filles descendaient dans la carrière des jeux olympiques, y disputaient le prix de la course, et la fournissaient presque toute entière. Les victorieuses obtenaient pour récompense une couronne d'olivier.
Carthage, fameuse capitale d'un vaste empire, passait pour être la ville favorite de Junon. Virgile ne s'est point servi des privilèges de son art, quand il a dit, en parlant de cette ancienne ville d'Afrique, la rivale de Samos dans cette occasion.
Quam Juno fertur, terris magis omnibus unam
Post habitâ coluisse Samo.
Aeneid. lib. I. Ve 15.
Son témoignage, fondé sur la tradition, est appuyé par Hérodote, Ovide, Apulée et Silvius Italicus. Ce dernier peignant l'attachement de Junon pour la ville de Carthage, déclare en trois beaux vers, qu'elle la préférait à Argos et à Mycènes.
Hic Juno ante Argos (sic credidit alta vetustas)
Ante Agamemnoniam, gratissima tecta Mycenem,
Optavit profugis aeternam condere sedem.
Lib. I. Ve 46.
Si nous passons en Italie, nous trouverons qu'avant l'existence de Rome, Junon jouissait déjà d'un temple à Falere en Toscane. Il ressemblait à celui d'Argos, et selon Denis d'Halicarnasse, on y suivait le rit des Argiens.
Cependant les conquérants de l'univers sortaient à peine d'une retraite de voleurs. A peine leur ville naissante était élevée au-dessus de ses fondements, que Tatius, collègue de Romulus, y établit le culte de la reine du ciel. Numa Pompilius, voulant à son tour gagner les bonnes grâces de cette divinité suprême, lui fit ériger un nouveau temple, et défendit, par une loi expresse, à toute femme débauchée d'y entrer, ni même de le toucher.
Sous le règne de Tullus Hostilius, les pontifes consultés sur l'expiation des meurtres involontaires, dressèrent deux autels, et y pratiquèrent les cérémonies qu'ils jugèrent propres à purifier le jeune Horace, qui venait de tuer sa sœur. L'un de ces autels fut consacré à Junon, et l'autre à Janus.
Tarquin le superbe lui voua le temple du capitole en commun avec Jupiter et Minerve ; et d'abord après la prise de Veïes, Camille lui en bâtit un en particulier sur le mont Aventin. En un mot, la fille de Saturne et de Rée, voyait tant de temples érigés uniquement en sa faveur dans tous les quartiers de Rome, qu'elle ne put plus douter de la vénération extraordinaire que lui portaient les Romains.
Aussi Virgile (& c'est un des beaux endroits de son Enéide) introduit ingénieusement Jupiter, annonçant à son épouse qu'il arriverait que les descendants d'Enée la serviraient plus dévotement que tous les autres peuples du monde, pourvu qu'elle voulut se desister de ses persécutions, à quoi la déesse ambitieuse consentit avec plaisir.
Hinc gens Ausonio mistam quod sanguine surget
Supra homines, supra ire Deos pietate videbis.
Nec gens ulla tuos aeque celebrabit honores.
Annuit his Juno, et mentem laetata retorsit.
Aeneid. lib. XII, Ve 838.
Les honneurs que Junon recevait dans d'autres villes d'Italie, n'étaient guère moins capables de la contenter. Elle était servie sous le titre de sospita, conservatrice, avec une dévotion singulière à Lanuvium, sur le chemin d'Appius. Il fallait même que les consuls de Rome, à l'entrée de leur consulat, allassent rendre leurs hommages à Junon Lanuvienne. Il y avait un grand trésor dans son temple, dont Auguste tira de grosses sommes, en promettant d'en payer l'intérêt, et s'assurant bien qu'il ne tiendrait jamais sa parole. On croit que ce temple avait été fondé par les Pélages, originaires du Péloponnèse ; et l'on appuie ce sentiment, sur ce que la Junon de Lanuvium est nommée par Elien, Juno Argolica.
Quoi qu'il en sait, nous devons à Ciceron, dans ses écrits de la nature des Dieux, liv. I. chap. xxix, le plaisir de connaître l'équipage de cette déesse. Cotta dit à Velleïus, " vôtre Junon tutélaire de Lanuvium ne se présente jamais à vous, pas même en songe, qu'avec sa peau de chèvre, sa javeline, son petit bouclier, et ses escarpins recourbés en pointe sur le devant ".
Mais le temple de Junon Lacinia, qu'on voyait à six milles de Crotone, est encore plus fameux dans l'histoire. Ne nous étonnons pas de la variété de sentiments qui règne touchant son fondateur et l'occasion de sa fondation : de tous temps les hommes ont inventé mille fables en ce genre ; on convient, et c'est assez, qu'il surpassait une fais, par son étendue, le plus grand temple de Rome. Il était couvert de tuiles de marbre, dont une partie fut transférée dans la capitale, l'an de sa fondation 579, pour couvrir le temple de la Fortune équestre, que Quintus-Fulvius Flaccus faisait bâtir.
Comme ce censeur périt misérablement, le sénat, par une action de piété et de justice, fit reporter les tuiles au même lieu d'où on les avait ôtées. Annibal n'exécuta pas le dessein qu'il avait d'enlever une colonne d'or de ce beau temple. Servius, Pline et Tite-Live récitent plusieurs choses miraculeuses, qu'on disait arriver dans cet endroit : mais Tite-Live n'en croyait rien ; car il ajoute : " on attribue toujours quelques miracles à ces sortes de lieux, surtout lorsqu'ils sont célèbres par leurs richesses et leur sainteté ". Pour cette fois cette remarque est d'un historien qui pense.
Au reste, on ne faurait réfléchir au culte qu'on rendait à Junon en tant de pays et avec tant d'appareil, sans en attribuer quelque chose à l'avantage de son sexe. Toute femme qui gouverne un état avec distinction, est généralement plus honorée et plus respectée que ne l'est un homme de pareille autorité. Les peuples ont transporté dans le ciel cet usage de la terre. Jupiter était considéré comme un roi, et Junon comme une reine ambitieuse, fière, jalouse, vindicative, implacable dans sa colere, d'ailleurs partageant le gouvernement du monde avec son époux, et assistant à tous ses conseils.
Un homme de génie du siècle passé, pensait que c'était de la même source que provenaient les excès d'adorations où des chrétiens sont tombés envers les saints et la vierge Marie, tant en Angleterre qu'ailleurs. Erasme lui même prétendait que la coutume de saluer la sainte vierge en chaire après l'exorde du sermon, était contre l'exemple des anciens, et qu'il vaudrait mieux les imiter.
Au titre de reine que portait Junon, et à sa qualité de femme, qui augmentait sa célébrité, nous joindrons, pour comble de prérogatives, la direction en chef qu'on lui donnait sur tous les mariages, et leurs suites naturelles : illi vincla jugalia curae, dit Virgile. Voyez ses commentateurs, ils vous indiqueront cent autres passages semblables, et vous expliqueront les épithetes de jugalis, de pronuba, de populonia, de , de , de , etc. qui ont été affectées à la femme de Jupiter, à cause de son intendance sur tous les engagements matrimoniaux.
Elle avait encore, en cette qualité, des surnoms particuliers, fondés sur ce qu'elle présidait à la conduite des nouvelles mariées, à la maison de leurs maris, à l'oignement que faisait la fiancée au jambage de la porte de son époux, et finalement au secours qu'elle accordait à cet époux pour dénouer la ceinture Virginale. Vous trouverez ces sortes de surnoms dans ces paroles latines, d'une prière à cette déesse du mariage. Iterducam, domiducam, unxiam, cinctiam, mortales puellae debent in nuptias convocare, ut earum itinera protegas, in optatas domos ducas, et quum postes ungent, faustum omnem affigas, et cingulum ponentes in thalamis, non relinquas. Cet hymne est dans Martianus Capella, de Nupt. Philol. lib. II.
Je n'ose indiquer les autres épithetes qu'on donnait à Junon, pour lui demander son assistance dans le lit nuptial : la chasteté de notre langue, et les égards que l'on doit à la pudeur, m'obligent de les taire.
Disons seulement que la superstition romaine était si grande, qu'il y avait des femmes qui honoraient Junon, en faisant semblant de la peigner et de la parer, et en lui tenant le miroir devant ses statues ; car c'était un proverbe, " que les coèffeuses présentaient toujours le miroir à Junon ", vetemus speculum tenere Junoni, s'écrie Seneque. D'autres femmes, animées de passions différentes, allaient s'asseoir au capitole auprès de Jupiter, dans l'espérance d'avoir ce dieu pour amant.
Je voudrais bien savoir la manière dont on représentait l'auguste déesse du ciel dans tous les divers rôles qu'on lui faisait jouer. En effet en la considérant seulement sous les titres de pronuba, d'opigena, de februa, de fluonia, ou comme présidant tantôt aux mariages, tantôt aux accouchements, tantôt aux accidents naturels du beau sexe, il semblait qu'elle devait être vêtue différemment dans chacune de ces diverses cérémonies.
Une matrone majestueuse, tenant la pique ou le sceptre à la main avec une couronne radiale sur la tête, et son oiseau favori couché à ses pieds, désignait bien la sœur et la femme de Jupiter : mais, par exemple, le croissant qu'on lui mettait sur la tête marquait vraisemblablement la déesse Ména, c'est-à-dire l'empire que Junon avait tous les mois sur le sexe.
C'est peut être pour la même raison qu'on la représentait sur les médailles de Samos avec des espèces de brasselets, qui pendaient des bras jusqu'aux pieds, et qui soutenaient un croissant : peut-être aussi que ces brasselets ne sont point un des attributs de Junon, mais un ornement de mode imaginé sous son nom, parce que cette déesse avait inventé la manière de s'habiller et de se coèffer.
Tristan, dans ses observations sur Callimaque, a donné le type d'une médaille des Samiens, représentant Junon ayant la gorge passablement découverte. Elle est vêtue d'une robe qui descend sur ses pieds, avec une ceinture assez serrée ; et le repli que la robe fait sur elle-même, forme une espèce de tablier. Le voîle prend du haut de la tête, et tombe jusqu'au bas de la robe comme faisaient les écharpes que nos dames portaient au commencement de ce siècle.
Le revers d'une médaille qui est dans le cabinet du roi de France, et que M. Spanheim a gravée, représente ce voîle tout déployé, qui fait deux angles sur les mains, un angle sur la tête, et un autre angle sur les talons.
Sur une des médailles du même cabinet, cette déesse est coèffée d'un bonnet assez pointu, terminé par un croissant. On voit sur d'autres médailles de M. Spanheim, une espèce de panier qui sert de coiffure à Junon, vêtue du reste à-peu-près comme nos religieux Bénédictins. La coiffure des femmes Turques, approche fort de celle de Junon, et les fait paraitre de belle taille. Cette déesse avait sans-doute inventé ces ornements de tête avantageux, et que les fontanges ont depuis mal imités.
Junon nuptiale, gamélienne, ou présidente aux noces, portait une couronne de souchet et de ces fleurs que nous appelons immortelles. On en couvrait une petite corbeille fort légère, que l'on arrêtait sur le haut de sa tête : c'est peut-être de-là que sont venues les couronnes que l'on met encore dans le levant sur la tête des nouvelles épouses ; et la mode n'en est pas entièrement passée parmi nous, quand on marie les jeunes filles.
Il y a des médailles de Maximin, au revers desquelles est le temple de Samos, avec une Junon en habit de noces, assez semblable à ceux dont on vient de parler, et ayant à ses pieds deux paons, oiseaux qui, comme l'on sçait, lui étaient consacrés, et qu'on élevait autour du temple de cette déesse.
Quelquefois l'épervier et l'aison accompagnent ses statues ; le dictamne, le pavot et la grenade étaient les plantes ordinaires que les Grecs lui offraient, et dont ils ornaient ses autels ; enfin la victime qu'on lui immolait communément, était l'agneau femelle ; Virgile nous le dit :
Junoni mactants lectas de more bidentes.
Il est temps de finir cet article de Junon ; mais quelque long qu'il sait, je n'ai pris que la fleur de l'histoire de cette déesse, sur son culte, ses temples, ses autels, ses attributs, ses statues et ses médailles, M. Bayle touche encore un autre sujet dans son dictionnaire ; c'est la considération de l'état des malheurs du cœur qui tirannisaient sans-cesse cette divinité selon le système populaire de la théologie payenne. Les poètes, les théâtres, les statues, les tableaux, les monuments des temples offraient mille preuves des amertumes de son âme, en peignant aux yeux de tout le monde son humeur altière, impérieuse, jalouse, toujours occupée de vengeances et ne goutant jamais une pleine satisfaction de ses succès. Le titre pompeux de reine du ciel, la séance sur le trône de l'univers, le sceptre à la main, le diadême sur la tête, tout cela ne pouvait adoucir ses peines et ses tourments. L'immortalité même y mettait le sceau ; car l'espérance de voir finir un jour ses chagrins par la mort, est une consolation que nous avons ici-bas. (D.J.)