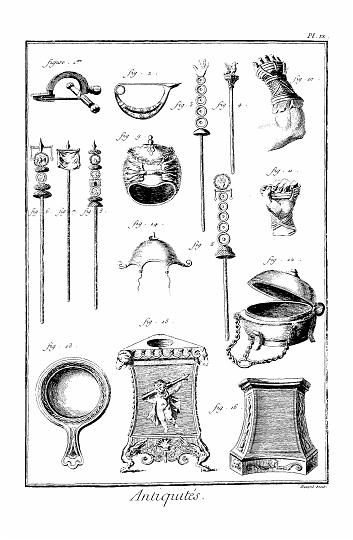sub. f. pl. (Histoire et Mythologie) filles d'Hesperus selon les uns, et d'Atlas selon les autres. Rapportons ici ce que l'Histoire nous a transmis de ces fameuses nymphes, et ce que les poètes en ont publié ; c'est tout ce que je veux extraire succinctement d'un grand mémoire que j'ai lu sur ce sujet, dans le recueil de l'académie des Inscriptions.
Selon Paléphate, Hesperus était un riche Milésien qui vint s'établir dans la Carie. Il eut deux filles nommées Hespérides, qui avaient de nombreux troupeaux de brebis, qu'on appelait brebis d'or, à cause de leur beauté ; ou, ce que j'aurais mieux aimé dire, à cause du produit qu'elles en retiraient. Ces nymphes, ajoute Paléphate, confièrent la garde de leur troupeau à un berger nommé Dracon ; mais Hercule passant par le pays qu'habitaient les filles d'Hesperus, enleva et le berger et le troupeau. Varron et Servius ont adopté ce récit simple et naturel.
D'autres écrivains en grand nombre, changent le berger des Hespérides en jardinier, et leurs troupeaux en fruits nommés pommes d'or par les Grecs, soit à cause de leur couleur, de leur goût excellent, ou de leur rapport. Cette seconde opinion n'a pas moins de partisans que la première ; et il semble même que dans la suite des temps elle soit devenue, surtout parmi les modernes, l'opinion dominante, en sorte que les uns ont entendu par ces pommes d'or des coings, d'autres des oranges, et d'autres des citrons.
Diodore ne prend point de parti sur ce dernier article, parce que, dit-il, le mot grec , dont les anciens auteurs se sont servis, peut signifier également des pommes ou des brebis, mais il entre dans les détails sur l'histoire même des Hespérides. Si nous l'en croyons, Hesperus et Atlas étaient deux frères, qui possédaient de grandes richesses dans la partie la plus occidentale de l'Afrique. Hesperus eut une fille appelée Hespérie, qui donna son nom à toute la contrée ; elle épousa son oncle Atlas, et de ce mariage sortirent sept filles, qu'on appela tantôt Hespérides, du nom de leur mère, et de leur ayeul maternel, tantôt Atlantides, du nom de leur père.
Elles faisaient valoir soigneusement, ou des troupeaux, ou des fruits, dont elles tiraient de bons revenus. Comme elles étaient aussi belles que sages, leur mérite fit beaucoup de bruit dans le monde. Busiris, roi d'Egypte, devint amoureux d'elles sur leur réputation ; et jugeant bien que sur la sienne il ne réussirait pas par une recherche régulière, il envoya des pirates pour les enlever. Ceux-ci épièrent le temps où elles se réjouissaient entr'elles dans un jardin, et exécutèrent l'ordre du tyran. Au moment qu'ils s'en retournaient tout fiers de leur proie, Hercule qui revenait de quelques-unes de ses expéditions, les rencontra sur le rivage, où ils étaient descendus pour prendre un repas. Il apprit de ces aimables filles leur aventure, tua les corsaires, mit les belles captives en liberté, et les ramena chez leur père.
Atlas charmé de revoir ses filles, fit présent à leur libérateur de ces troupeaux, ou de ces fruits, qui faisaient leurs richesses. Hercule, fort content de la réception d'Atlas, qui l'avait même initié par surcrait de reconnaissance dans les mystères de l'Astronomie, revint dans la Grèce, et y porta les présents dont son hôte l'avait comblé.
Pline embrasse l'opinion de ceux qui donnent des fruits et non des troupeaux aux Hespérides, et parait vouloir placer leurs jardins à Lixe, ville de Mauritanie : un bras de mer, dit-il, serpente autour de cette ville, et c'est ce bras de mer qui a donné aux poètes l'idée de leur affreux dragon.
Si l'on suit les autres historiens, de la narration desquels je ne me propose point d'ennuyer le lecteur, on trouvera que ce qu'il y a d'incontestable touchant les Hespérides se réduit à ces trois ou quatre articles : qu'elles étaient sœurs ; qu'elles possédaient une sorte de bien, dont elles étaient redevables à leurs soins et à la bonté du terroir qu'elles cultivaient ; que leur demeure était bien gardée ; et qu'enfin Hercule étant allé chez elles, il remporta dans la Grèce de ces fruits, ou de ces troupeaux, qui leur étaient d'un bon revenu.
Mais il faut voir ce que les poètes ont fait de ce peu de matière, et quelle forme ils ont su lui donner. Ils changent le lieu qu'habitaient les Hespérides en un jardin magnifique et délicieux ; l'or y brille de toutes parts ; les fruits, les feuilles et les rameaux que portent ces arbres, sont de ce précieux métal ; Ovide nous en assure,
Arboreae frondes, auro radiante nitentes
Ex auro ramos, ex auro poma ferebant.
Métam. lib. IV.
Toutes ces richesses sont gardées par un horrible dragon, qui a cent têtes, et qui pousse en l'air cent différentes sortes de sifflements ; aussi les pommes sur lesquelles il tient sans-cesse les yeux ouverts, charment la vue par leur beauté, et font sur les cœurs des impressions dont il est impossible de se défendre. Lorsque Jupiter épousa Junon, cette déesse lui porta de ces pommes en mariage, et ne crut pas pouvoir lui payer sa dot plus magnifiquement. Ce fut avec une de ces pommes que la Discorde mit la division entre trois des plus grandes divinités du ciel, entre Junon, Vénus et Pallas ; et par cette seule pomme, elle jeta le trouble dans tout l'olympe. Ce fut avec ces mêmes pommes qu'Hippomene adoucit la fière Atalante, la rendit sensible à ses vœux, et lui fit éprouver toutes les fureurs de l'amour.
Tandis que ces mêmes poètes font de ces jardins un séjour ravissant, ils font de celles qui l'habitent autant d'enchanteresses ; elles ont des voix admirables ; elles tempèrent leurs travaux par des concerts divins ; elles aiment à prendre toutes sortes de figures, et à étonner les yeux des spectateurs par des métamorphoses également soudaines et merveilleuses. Les Argonautes arrivent-ils auprès d'elles, Hespéra devient un peuplier, Erythéis est un ormeau, Eglé se change en saule.
Il ne restait plus aux poètes, pour rendre les Hespérides respectables de tout point, que de les marquer au coin de la religion, et que d'en créer des divinités dans toutes les formes. Ces beaux génies n'y ont pas manqué : ils leur ont donné un temple ; ils y ont joint une prêtresse, redoutable par l'empire souverain qu'elle exerce sur toute la nature. C'est cette prêtresse qui garde elle-même les rameaux sacrés, et qui nourrit le dragon de miel et de pavots. Elle commande aux noirs chagrins, et sait à son gré les envoyer dans les cœurs des mortels, ou les chasser de leur âme avec la même facilité ; elle arrête le cours des fleuves ; elle force les astres à retourner en arrière ; elle contraint les morts à sortir de leurs tombes ; on entend la terre mugir sous ses pieds, et à son ordre on voit les ormeaux descendre des montagnes. Loin d'exagérer, je ne fais que rendre en mauvaise prose la peinture qu'en fait Virgile en de très-beaux vers :
Hesperidum templi custos, epulasque draconi
Quae dabat, et sacros servabat in arbore ramos ;
Spargens humida mella, soporiferumque papaver ;
Haec se carminibus promittit solvère mentes,
Quas velit, ast aliis duras immittère curas :
Sistère aquam fluviis, et sidera vertère retrò,
Nocturnos terram, et descendere montibus ornos.
C'est ainsi que les poètes peuvent tout embellir ; et que, grâce à leurs talents, ils trouvent dans les sujets les plus stériles des sources inépuisables de merveilles.
Peu nous doit importer, si l'on remarque dans leurs embellissements une infinité de différences. Ce sont des choses inséparables des fictions de l'esprit humain, et ce serait une entreprise ridicule de vouloir les concilier. C'est assez que les poètes conviennent ensemble que les Hespérides sont sœurs ; que leurs richesses consistaient en pommes d'or ; que ces pommes étaient gardées par un dragon ; qu'Hercule pourtant trouva le moyen d'en cueillir, et d'en emporter dans la Grèce. Mais, dira-t-on, ils sont divisés sur presque tous les autres faits ; ils ne s'accordent, ni sur la naissance de ces nymphes, ni sur leur nombre, ni sur la généalogie du dragon, ni sur le lieu où les jardins des Hespérides étaient situés, ni finalement sur la manière dont Hercule s'y prit pour avoir de leurs fruits. Tout cela est très-vrai, mais ces variétés d'idées ne nuisent à personne ; les fictions ingénieuses seront celles auxquelles nous donnerons notre attache, sans nous embarrasser des autres.
Hésiode, par exemple, veut que les Hespérides soient nées de la Nuit ; peut-être donne-t-il une mère si laide à des filles si belles, parce qu'elles habitaient à l'extrémité de l'occident, où l'on faisait commencer l'empire de la Nuit. Lorsque Chérécrate au contraire les fait filles de Phorcus et de Céto, deux divinités de la mer, cette dernière fiction nous déplait, parce que c'est une énigme inexplicable.
Quant au nombre des Hespérides, les poètes n'ont rien feint d'extraordinaire. La plupart ont suivi l'opinion commune qui en établit trois, Eglé, Aréthuse et Hespéréthuse. Quelques-uns en ajoutent une quatrième, qui est Hespéra ; d'autres, une cinquième, qui est Erythéis ; d'autres, une sixième, qui est Vesta ; et ces derniers mêmes n'ont point exagéré, puisque Diodore de Sicile, historien, fait monter le nombre de ces nymphes jusqu'à sept.
Leur généalogie du dragon nous est fort indifférente en elle-même, soit qu'on le suppose fils de la Terre avec Pysandre, ou de Typhon et d'Echidne avec Phérécide. Mais les couleurs dont quelques-uns d'eux peignent ce monstre expirant, nous émeuvent et nous intéressent. Ce n'est pas une description de mort ordinaire qu'on lit dans Apollonius, c'est un tableau qu'on croit voir : " Le dragon, dit-il, percé des traits d'Hercule, est étendu au pied de l'arbre ; l'extrémité de sa queue remue encore, le reste de son corps est sans mouvement et sans vie ; les mouches s'assemblent par troupes sur le noir cadavre, sucent et le sang qui coule des plaies et le fiel amer de l'hydre de Lerne, dont les flèches sont teintes. Les Hespérides désolées à ce triste spectacle, se couvrent le visage de leurs mains, et poussent des cris lamentables "...
En un mot, de telles descriptions nous affectent, tandis que nous ne sommes point épris des prétendus mystères qu'on prétend que ces fictions renferment, et des explications historiques, morales ou physiques qu'on nous en a données ; encore moins pouvons-nous goûter les traces imaginaires que des auteurs, plus chrétiens que critiques, croient apercevoir dans ces fables de certaines vérités que contiennent les livres sacrés. L'un retrouve dans les pommes, ou dans les brebis des Hespérides, Josué qui pille les troupeaux et les fruits des Cananéens ; l'autre se persuade que le jardin des Hespérides, leurs pommes et leur dragon ont été faits d'après le paradis terrestre. Non, non, les poètes, en forgeant la fable de ces aimables nymphes, n'ont point corrompu l'Ecriture-sainte, qu'ils ne connaissaient pas ; ils n'ont point voulu nous cacher des mystères, ni nous donner aucunes instructions. C'est faire trop d'honneur à ces agréables artisans de mensonges que de leur prêter des intentions de cette espèce ; ils se sont uniquement proposés de nous amuser, d'embellir leur sujet, de donner carrière à leur enthousiasme, d'exciter l'admiration et la surprise, en un mot de peindre et de plaire, et l'on doit avouer qu'ils ont eu, pour la plupart, le secret de réussir. (D.J.)
HESPERIDES, îles des, (Géographie ancienne) îles de la mer Atlantique ; Pline, l. VI. c. xxxj. n'en parle qu'avec incertitude ; ce qu'il en dit, ne convient point aux Canaries, encore moins aux Açores, ni aux Antilles ; il met une journée de navigation depuis les îles Hespérides au cap nommé Hesperu-ceras ; il parcourt donc la côte occidentale d'Afrique : le cap qu'il nomme Hesperu-ceras doit être le Cap-verd ; les Héspérides étaient, dit-il, à une journée en-deçà de Hesperu-ceras ; seraient-ce deux des îles du Sénégal ? Mais enfin quel fonds peut-on faire sur des relations imparfaites, et dressées dans des temps où ces lieux n'étaient connus que par une tradition également obscure et incertaine. (D.J.)