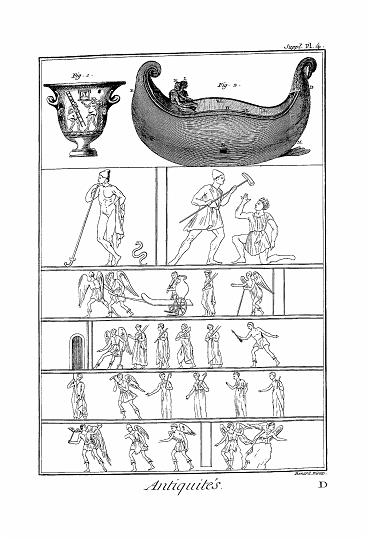- Détails
- Écrit par : Louis-Jacques Goussier (D)
- Catégorie : Antiquité & Médailles
Quelquefois on confond la fécondité avec la déesse Tellus, et alors elle est représentée nue jusqu'à la ceinture, et à demi-couchée par terre, s'appuyant du bras gauche sur un panier plein d'épis et autres fruits, auprès d'un arbre ou sep de vigne qui l'ombrage, et de son bras droit elle embrasse un globe ceint du zodiaque, orné de quelques étoiles ; c'est ainsi qu'elle est représentée dans quelques médailles de Julia Domna ; dans d'autres, c'est seulement une femme assise, tenant de la main gauche une corne d'abondance, et tendant la droite à un enfant qui est à ses genoux ; enfin, dans d'autres médailles c'est une femme qui a quatre enfants, deux entre ses bras et deux debout à ses côtés : voilà sans-doute le vrai symbole de la fécondité.
- Clics : 2153
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Antiquité & Médailles
Lorsque les Lydiens eurent détruit Smyrne, la campagne d'alentour n'était peuplée que de villages pendant quatre cent ans ou environ. Antigonus la rebâtit, et Lysimachus après lui ; c'est aujourd'hui une des plus belles villes d'Asie. Une partie est bâtie sur la montagne ; mais la plus grande partie est dans une plaine, sur le port, vis-à-vis du temple de la mère des dieux et du gymnase ou de l'école. Les rues sont les plus belles du monde, coupées en angles droits, et pavées de pierre. Il y a de grands portiques carrés au plus haut et au plus bas de la ville, avec une bibliothèque et un homérion qui est un portique carré avec un temple où est la statue d'Homère : car ceux de Smyrne sont fort jaloux de ce qu'Homère a pris naissance parmi eux, et ils ont un médaillon de cuivre qu'ils appellent homérion de son nom. La rivière de Melès coule le long des murailles. Entre les autres commodités de la ville, il y a un port qui se ferme quand on veut.
- Clics : 2350
- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Antiquité & Médailles
Ce n'était pas seulement le dieu tutélaire de toute l'Egypte en général, plusieurs des principales villes de ce royaume l'avaient choisi pour leur patron particulier, et le firent graver sur leurs monnaies en cette qualité ; mais entre toutes ces villes, aucune ne lui rendit des honneurs plus solennels et plus surprenans que celle d'Alexandrie. Alexandria civitas quae conditorem Alexandrum macedonem gloriatur, Serapin atque Isin cultu penè attonitae venerationis observat, dit Macrobe, liv. I. Saturn.
- Clics : 2869
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Antiquité & Médailles
Cette tour de Scutari est nommée par les Turcs tour de la Pucelle ; mais les Francs ne la connaissent que sous le nom de la tour de Léandre, quoique la vraie tour, la fameuse tour qui porte indifféremment dans l'histoire, le nom de tour de Léandre, ou celui de tour de Héro, comme Strabon l'appelle , fût située sur les bords du canal des Dardanelles.
- Clics : 2183
- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Antiquité & Médailles
Le mot de vint insensiblement à désigner tout chef, tout supérieur ; il arriva même qu'on donne ce nom à des hommes qui exerçaient des charges purement civiles ou sacrées. On trouve dans les actes des apôtres, ch. XVIe Ve 20. ce mot employé pour signifier les magistrats d'une ville, , c'est-à-dire, et les amenant devant les magistrats.
- Clics : 1541