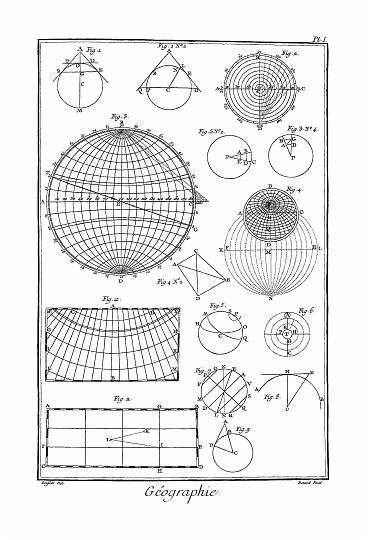- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Marine
- Clics : 850
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Marine
Voir par proue, c'est-à-dire, devant soi. Donner la proue, c'est prescrire la route que les galeres doivent tenir. On dit, le chef-d'escadre fit venir les galeres à son bord, pour leur donner la proue qu'elles tiendraient. Lorsqu'on parle des vaisseaux, on dit donner la route.
- Clics : 815
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Marine
- Clics : 853
- Détails
- Écrit par : Guillaume Le Blond (Q)
- Catégorie : Marine
Rabans d'avuste, ce sont des cordages faits à la main de quatre ou six fils de carret.
Rabans de pavillon, rabans qui sont passés dans la gaine du pavillon, pour les amarrer au bâton du pavillon.
- Clics : 1055
- Détails
- Écrit par : Jacques-Nicolas Bellin (Z)
- Catégorie : Marine
La racle double, est une racle à deux tranchans.
Grande racle, est celle qui sert à nettoyer les parties qui sont sous l'eau.
Et la petite racle, est celle qui sert à nettoyer les parties qui sont hors de l'eau. (Z)
- Clics : 824