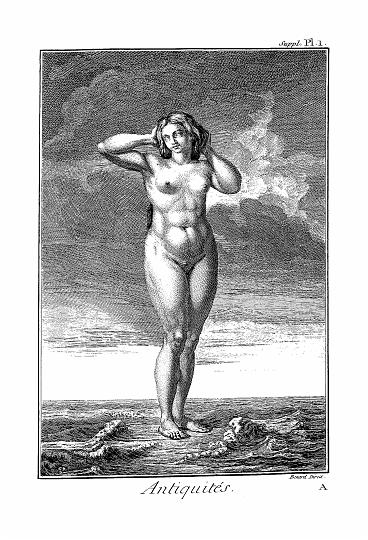S. f. (Marine) c'est un vaisseau de guerre peu chargé de bois, qui n'est pas haut élevé sur l'eau, leger à la voile, et qui n'a ordinairement que deux ponts. On prétend que les Anglais ont été les premiers qui aient appelé frégates sur l'Océan, les bâtiments longs armés en guerre, qui ont le pont beaucoup plus bas que celui des galions ou des navires ordinaires. Ce mot de frégate tire son origine de la mer Méditerranée, où l'on appelait frégates de longs bâtiments à voîle et à rame qui portaient couverte, et dont le bord qui était beaucoup plus haut que celui des galeres, avait des ouvertures comme des sabords pour passer les rames : mais cette sorte de bâtiments n'est plus d'usage, et les frégates sont aujourd'hui des vaisseaux de guerre qui vont après les vaisseaux du troisième rang, et l'on désigne leur force et leur grandeur par le nombre de leurs canons.
Les frégates depuis 32 canons jusqu'à 46 ont deux ponts, deux batteries complete s, un gaillard, un barrot en-avant du grand-cabestan, un château d'avant de 23 pieds de long.
Les frégates depuis 30 jusqu'à 32 canons ont deux ponts, une batterie complete sur le deuxième pont, un gaillard jusqu'au grand-cabestan, un château d'avant de 20 pieds de long. On peut faire une frégate de ce rang qui n'aurait qu'un pont, une batterie complete , et un gaillard, avec un château d'avant, qui seraient séparés au milieu de la distance nécessaire pour placer la chaloupe sur le pont.
Une frégate de 28 canons a deux ponts, et la plus grande partie du canon se place sur le deuxième pont ; il n'y a sur le premier que huit canons, quatre de chaque côté, un gaillard prolongé de trois barrots en-avant du mât d'artimon, et un château d'avant de 19 pieds de longueur.
Depuis quelque temps on a changé cet usage, et maintenant une frégate de 28 à 30 canons n'aurait qu'un pont, sur lequel il y aurait 24 canons, et quatre ou six sur son gaillard d'arrière. Cette disposition est bien meilleure, quand les frégates ont leur batterie élevée ; car les huit canons qu'on mettait sur le premier pont étant fort près de l'eau, étaient presque toujours hors de service.
Une frégate de 22 à 24 canons n'a qu'un pont, un gaillard, et un château d'avant de 18 pieds de longueur.
Au-dessous de 20 canons ce ne sont plus des frégates ; on les nomme corvettes, qu'on distingue comme les frégates, par le nombre de leurs canons.
Ce qu'on vient de voir est tiré de l'architecture navale, que j'ai eu occasion de citer en plus d'un endroit ; et pour entrer dans un plus grand détail, j'y ai joint le devis d'une frégate de cent quarante-cinq pieds de long de l'étrave à l'étambot, trente-six pieds de bau, et quinze pieds de creux, dressé par un habîle constructeur.
La frégate a cent trente pieds de quille portant sur terre, et la quille a un pied neuf pouces en carré.
L'étrave a vingt-huit pieds de hauteur à l'équerre, un pied cinq pouces d'épaisseur, trois pieds cinq pouces de large par le haut, deux pieds dix pouces au milieu, trois pieds cinq pouces par le bas, trois pieds trois pouces de ligne courbe, douze pieds quatre pouces de quête.
L'étambot a vingt-sept pieds de long à l'équerre, un pied sept pouces d'épais, deux pieds de large par le haut, deux pieds sept pouces à la pointe de l'arcasse, sept pieds par le bas, neuf pouces de ligne courbe, deux pieds sept pouces de quête.
La lisse de hourdi a vingt-sept pieds de long, un pied neuf pouces d'épais, un pied sept pouces de large en son milieu, un pied cinq pouces par les bouts, un pied d'arc ou de rondeur.
La pointe de l'arcasse en-dehors est à douze pieds au-dessous de la tête de l'étambot, ou de son bout d'en-haut.
Les allonges de poupe ont vingt-quatre pieds de hauteur, prise au niveau de la tête de l'étambot, et sont à la distance de seize pieds l'une de l'autre.
Des deux grands gabarits, celui qui est le premier du côté de l'arrière est posé à soixante et quinze pieds du dehors de l'étambot, et l'autre est onze pieds plus en-avant. Le premier gabarit de l'avant est posé sur le ringot, et a trente-deux pieds six pouces de distance d'un de ses côtés à l'autre à la baloire. Le dernier gabarit ou le premier de l'arrière, est posé à autant de distance de l'étambot que l'étrave a de quête, ou un peu plus, c'est-à-dire à douze pieds six pouces. Il y a de distance de l'un de ses côtés à l'autre, vingt-neuf pieds six pouces pris à la baloire, et vingt-quatre pieds pris à neuf pieds de hauteur au-dessus de la quille.
La plus basse préceinte a un pied trois pouces de large, et sept pouces d'épais ; la seconde a un pied deux pouces de large, et sept pouces d'épais ; la fermure qui est entre-deux, a un pied neuf pouces de large ; et la troisième préceinte a un pied un pouce et demi de large, et la fermure, qui est la fermure des sabords, a deux pieds six pouces ; la quatrième préceinte a un pied un pouce de large, et six pouces d'épais, et la fermure entre la troisième et la quatrième, a un pied quatre pouces aussi de largeur. La lisse de vibord a un pied de large, et six pouces d'épais ; le bordage entre la quatrième préceinte et la lisse de vibord, a deux pieds trois pouces ; et les sabords de la seconde bande y sont percés.
Le grand mât a quatre-vingt-six pieds de long, et deux pieds six pouces d'épais dans l'étambraie. Le ton pris sur les barres de hune, a neuf pieds de hauteur ; et sous les barres de hune,, six pieds neuf pouces. Le mât de misene a soixante et dix-sept pieds de long, et deux pieds trois pouces et un quart d'épaisseur ou de diamètre dans l'étambraie. Le ton pris sur les barres de hune a six pieds de long, et quatre pieds six pouces sous les barres. Le mât d'artimon a soixante-quatre pieds cinq pouces de long, et un pied sept pouces et demi d'épais dans l'étambraie. Le ton pris sur les barres de hune, a six pieds de long et quatre pieds six pouces sous les barres. Le mât de beaupré a cinquante-quatre pieds de long, et deux pieds quatre pouces et demi d'épais sur l'étrave en-dedans. Le grand mât de hune a soixante pieds de long ; le mât de hune d'avant, cinquante-quatre pieds ; le grand perroquet, vingt-sept pieds ; le perroquet d'avant, vingt-trois pieds. (Z)
FREGATE LEGERE, (Marine) c'est un vaisseau de guerre bon voilier, qui n'a qu'un pont. Il est ordinairement monté depuis seize jusqu'à vingt-quatre pièces de canon. (Z)
FREGATE, (Histoire naturelle, Ornithologie) oiseau des Antilles ainsi appelé, parce que son vol est très-rapide. Il n'a pas le corps plus gros qu'une poule ; mais il est très-charnu. Les plumes du mâle sont noires comme celles du corbeau ; lorsqu'il est vieux, il a sous la gorge une grande crête rouge comme celle d'un coq. La femelle n'en a point ; ses plumes sont blanches sous le ventre. Le cou est médiocrement long, et la tête petite. Les yeux sont gros, noirs, et aussi perçans que ceux de l'aigle ; le bec est de couleur noire, long de six à sept pouces, assez gros, droit dans la plus grande partie de sa longueur, et crochu à l'extrémité ; les pattes sont fort courtes, et les serres ressemblent à celles du vautour, mais elles sont noires. Cet oiseau a sept à huit pieds d'envergure : aussi on prétend qu'il s'éloigne des terres de plus de trois cent lieues : quoiqu'il s'élève quelquefois à une grande hauteur, il aperçoit toujours les poissons volans qui s'élèvent au-dessus de l'eau pour se sauver des dorades : alors les frégates s'abaissent précipitamment jusqu'à une certaine distance de la surface de la mer, et enlèvent les poissons volans dans leur bec, ou dans leur serres. On a donné le nom d'îlette des frégates, à une île dans le petit cul-de-sac de la Guadeloupe, parce qu'on y trouvait beaucoup de ces oiseaux qui venaient des environs pour passer la nuit dans cette ile, et pour y faire leur nid : mais on les a obligé de la déserter en leur donnant la chasse, pour avoir de leur graisse, que l'on regarde dans les Indes comme un souverain remède contre la sciatique. On les frappe avec de longs bâtons, lorsqu'elles sont sur leur nid, et elles tombent à demi-étourdies. On a Ve dans une de ces chasses, que les frégates qui prenaient leur essor étant épouvantées, rejetaient chacune deux ou trois poissons grands comme des harengs, en partie digérés. Histoire naturelle des Ant. par le P. du Tertre, tom. II. (I)