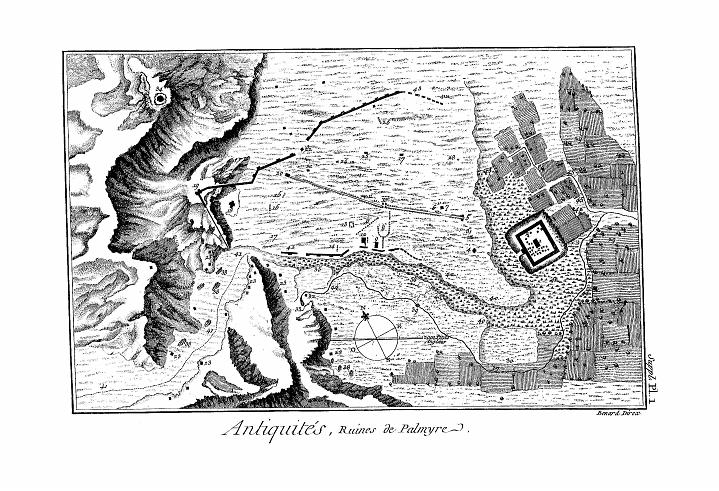S. m. (Marine) Prendre le fanon de l'artimon, c'est le raccourcissement du point de la voîle que l'on trousse et ramasse avec des garcettes, pour prendre moins de vent ; ce qui ne se fait que dans de très-gros temps. Ce mot est particulièrement pour la voîle d'artimon, et quelquefois pour la misene. (Z)
FANON, terme de Chirurgie, pièce d'appareil pour la fracture des extrémités inférieures. On fait les fanons avec deux baguettes ou petits bâtons de la grosseur du doigt : chaque baguette est garnie de paille, qu'on maintient autour du bâton avec un fil qui l'entortille d'un bout à l'autre. La longueur des fanons est différente, suivant la grandeur des sujets, et suivant la partie fracturée. Les fanons qui servent pour la jambe doivent être d'égale longueur, et s'étendre depuis le dessus du genou jusqu'à quatre travers de doigts au-delà du pied. Ceux qui doivent maintenir la cuisse sont inégaux ; l'externe doit aller depuis le dessus du pied jusqu'au-delà de l'os des îles ; l'interne est plus court, et doit se terminer supérieurement au pli de la cuisse, et ne point blesser les parties naturelles. Le mot de fanon signifie un bâton de torche. Pour s'en servir on les roule un de chaque côté dans les parties latérales d'une pièce de linge d'une longueur et d'une largeur suffisantes, sur le plein de laquelle la partie puisse être placée avec tout l'appareil qui y est appliqué. Voyez Planche IV. de Chirurgie, figure 1. On serre les fanons des deux côtés du membre ; mais avant de les attacher par le moyen de trois ou quatre liens ou rubans de fil qu'on a eu soin de passer par-dessous, on a l'attention de mettre des compresses assez épaisses pour remplir les vides, comme au-dessous du genou, et au-dessus des malléoles ou chevilles, afin que les fanons fassent une compression égale dans toute la longueur du membre, et qu'ils ne blessent point les parties sur lesquelles ils porteraient si elles n'étaient point garnies. Dans quelques hôpitaux on a pour cet usage des petits sachets remplis de paille d'avoine. On noue extérieurement les rubans qui serrent les fanons contre le membre, et on met ordinairement une petite compresse carrée au milieu de la partie antérieure de la partie, sous chacun de ces rubans pour les soutenir, et remplir le vide qu'il y aurait entre le ruban et l'appareil. On voit assez par cette description, quel est l'usage des fanons ; ils maintiennent la partie fracturée dans la direction qu'on lui a donnée, et s'opposent à tous les mouvements volontaires et involontaires, plus que toute autre partie de l'appareil ; ils servent aussi à éviter le dérangement dans le transport qu'on est quelquefois obligé de faire d'un blessé d'un lit dans un autre.
Lorsque les fanons sont appliqués, on doit poser le membre sur un coussin ou oreiller, dans une situation un peu oblique, en sorte que le pied soit plus élevé que le genou, et le genou plus que la cuisse ! cette position favorise le retour du sang des extrémités vers le centre. Dans les hôpitaux militaires, où l'on n'a point d'oreillers, on met la partie dans des faux-fanons. On donne ce nom à un drap plié de façon, qu'il n'ait de large que la hauteur des fanons ; on le roule par les deux extrémités, et on place le membre entre ces deux rouleaux, qui servent à soutenir les fanons, et même à soulever la partie, et à donner un peu d'air par-dessous, quand on le juge à propos. Voyez FLABELLATION. On met quelquefois les faux-fanons doubles, pour élever le membre davantage. Quand au lieu de drap on n'a que des alaises ou des nappes, il faut s'accommoder aux circonstances : alors on roule séparement les pièces de linge qu'on a, et on met les unes d'un côté et les autres de l'autre, pour remplir l'intention marquée.
Les anciens mettaient tout simplement le membre dans une espèce de caisse qui contenait fort bien tout l'appareil. M. Petit a perfectionné cette pratique : la boite qu'il a imaginée, contient avantageusement les jambes fracturées, et elle est surtout très-utîle dans les fractures compliquées de plaie qui exige des pansements fréquents. Voyez BOITE.
M. de la Faye a inventé aussi une machine pour contenir les fractures, tant simples que compliquées ; elle est composée de plusieurs lames de fer blanc unies par des charnières : il suffit de garnir la partie de compresses, et l'on roule cette machine par-dessus, comme une bande. Cette machine, qui peut être de grande utilité à l'armée dans le transport des blessés, pour empêcher les accidents fâcheux qui résultent du froissement des pièces fracturées, est décrite dans le second volume des mémoires de l'académie royale de Chirurgie. M. Coutavoz, membre de la même société académique, a fait à cette machine des additions très-importantes pour un cas particulier, dont il a donné l'observation dans le même volume.
Dans une campagne où l'on n'aurait aucun de ces secours, où l'on manquerait même de linge, un chirurgien intelligent ne serait pas excusable, si son esprit ne lui suggérait quelque moyen pour maintenir les pièces d'os fracturées dans l'état convenable ; on peut faire une boite ou caisse avec de l'écorce d'arbre, et remplir les inégalités de la partie avec quelque matière molle, comme serait de la mousse, etc. Voyez FRACTURE. (Y)
FANON, (Manège et Maréchalerie) On appelle de ce nom cet assemblage de crins qui tombent sur la partie postérieure des boulets, et cachent celle que nous nommons l'ergot. Leur trop grande quantité décele des chevaux épais, grossiers et chargés d'humeurs ; elle est d'autant plus nuisible, qu'elle ne sert qu'à receler la crasse, la boue et toutes les matières irritantes, que nous regardons avec raison comme les causes externes d'une foule de maux qui attaquent les jambes de l'animal. On emploie des cisailles ou pinces à poil, pour dégarnir le fanon. Voyez PANSER. (e)