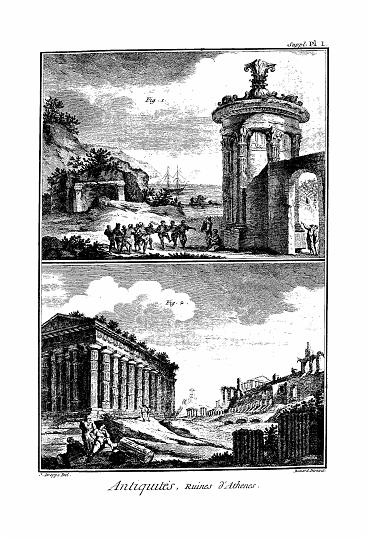- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Géographie moderne
- Clics : 1057
- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Géographie moderne
- Clics : 1051
- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Géographie moderne
Louis XI s'empara de Sémur après la mort du dernier duc de Bourgogne, et depuis ce temps-là elle a été réunie à la couronne de France. Elle est gouvernée par un majeur, six échevins, et un procureur ; mais il y a prevôté royale, présidial, grenier à sel, maréchaussée, et plusieurs couvens. Son commerce consiste en blé et en bestiaux. C'est la seule ville de Bourgogne qui demeura fidèle au roi pendant la ligue. Henri IV par reconnaissance, y convoqua les états généraux de la province en 1590, et y transféra en 1590 le parlement de Dijon, qui y tint ses séances jusqu'à la paix. Long. 21, 43. latit. 47, 25.
- Clics : 2354
- Détails
- Écrit par : Auteur anonyme
- Catégorie : Géographie moderne
- Clics : 1015
- Détails
- Écrit par : Louis de Jaucourt (D.J.)
- Catégorie : Géographie moderne
- Clics : 2517